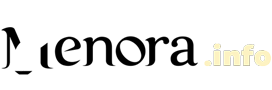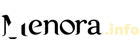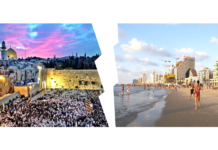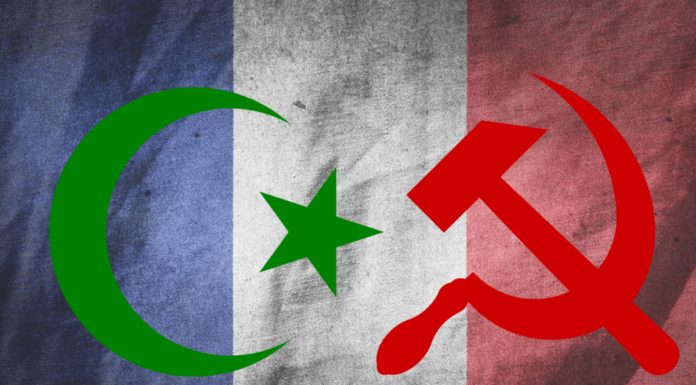Les signes, les mythes, les lieux et les héros sont les éléments qui composent et définissent la religion civile de l’Etat d’Israël. Comme tout Etat portant un projet de type moral, ils traduisent ce projet et son évolution.
Jusqu’à aujourd’hui, pour qui veut comprendre le processus de construction de l’identité israélienne, l’ouvrage de Charles Liebman et Eliezer Don-Yehiya « Civil Religion in Israel, Traditional Judaism and Political Culture in the Jewish State » (1983), demeure une référence. Il analyse l’impact du judaïsme sur la culture politique d’Israël, de la période pré-étatique du Yichouv jusqu’au début des années 80 du XXe siècle. Les auteurs y recensent « les cérémonies, les mythes et les croyances qui légitiment l’ordre social, unissent la population et mobilisent les membres de la société dans la poursuite des objectifs politiques dominants ».
Le concept de religion civile, pensé par Jean-Jacques Rousseau, y est décrit comme un système de symboles qui donne une légitimation sacrée à l’ordre social. Elle place en son centre la collectivité pour en organiser l’environnement et former des expériences de fusion des individus dans une identité commune. Mais cette sanctification de la société porte ses propres limites, car elle ne peut produire la même intensité de réponses et d’engagements que génère la religion traditionnelle, qui s’articule autour du divin et de la transcendance. De plus, quand le noyau d’un système est par définition évolutif, comme peut l’être une société, sa structure évolue avec elle. Ce qui explique que les mythes et les signes qui forgent cette identité israélienne aient muté au fil du temps et qu’ils continuent à le faire. Seuls les symboles de l’Etat, sanctuarisés par la loi, conservent leur permanence.
Les symboles de l’Etat d’Israël
Drapeau : symbole par excellence, puisqu’il est la représentation de l’Etat à l’intérieur et à l’extérieur. Adopté par le Congrès de Bâle de l’Organisation Sioniste Mondiale de 1897, il a été celui du Mouvement Sioniste jusqu’à l’indépendance. Le débat sur la forme définitive du drapeau de l’Etat proposait différentes formules, dont celle du drapeau conçu par Théodore Herzl des sept étoiles d’or, qui auraient été modifiées en étoiles de David. Le comité chargé de trancher a donc finalement opté en 1948 pour le drapeau de l’Organisation Sioniste Mondiale, inspiré du talith, le châle de prière juif, portant deux barres horizontales et une étoile de David bleu azur en son centre sur fond blanc. Ses dimensions, proportions et couleurs sont définies par une loi votée par la Knesset en mai 1949.
Hymne : L’Hatikva, « l’espoir », fut tout d’abord l’hymne du Mouvement Sioniste. Ses deux couplets sont adaptés d’un poème composé en 1878 par Naftali Hertz Imber. La mélodie est inspirée d’une musique populaire de Moldavie, adaptée par en 1888 par Samuel Cohen, qui a mis en musique le texte de Imber. Hymne national depuis 1948, l’Hatikva n’a pourtant été officialisé comme tel qu’en 2004, par un amendement à la loi de 1949 sur le drapeau et le symbole de l’Etat.
Symbole national : il est composé de la représentation du chandelier à sept branches, la Menorah du Temple, telle que figurant sur l’Arche de Titus et entourée de deux rameaux d’olivier au-dessus de l’inscription du mot « Israël ». Mis en forme par les frères Gabriel et Maxime Shamir, il s’inspire de la prophétie de Zacharie. Le choix de la Menorah, à la fois représentation religieuse, mais aussi symbolique de lumière, a été considéré comme suffisamment consensuel pour être accepté tant par les religieux que par les laïcs. Il figure également dans les dispositions de la loi de 1949.
Les mythes refondateurs
Un mythe est une histoire qui porte une résonance émotionnelle forte, afin de transmettre et de renforcer des valeurs sociétales fondamentales. Un mythe politique a une fonction cathartique. Dans le cas du sionisme, la difficulté apparait dès le départ : celle de l’ambivalence par rapport à la tradition juive. S’agit-il d’un héritage ou d’un rejet ? En refusant les valeurs du judaïsme traditionnel, le sionisme perd de son universalité et sa légitimité à parler au nom de tout le peuple juif. Mais en les conservant, il ne s’affranchit pas de la conception diasporique. Le sionisme socialiste, le sionisme révisionniste puis l’étatisme, ont construit leurs propres mythes. L’évolution de la réalité étatique d’Israël en poursuit le façonnement et la formulation, parfois dans des allers-retours qui confirment que le projet sioniste est toujours en devenir.
Ascension et chute de Massada
Le siège de la forteresse d’Hérode par les Romains et le suicide des zélotes qui préférèrent la mort à la reddition fut longtemps relégué par la tradition juive. Ce sont les sionistes qui remirent le récit à l’ordre du jour. Malgré l’aspect problématique du suicide, l’histoire portait des valeurs compatibles avec le projet national, à commencer par l’expression de la volonté de ses héros, qui sont restés jusqu’au bout maitres de leur destin. Massada résonnait aussi familièrement à ceux qui luttaient pour établir de nouvelles implantations juives en Eretz Israël, même quand il fallait parfois les abandonner après des luttes héroïques.
Après la création de l’Etat, on ne veut plus d’un récit qui se clôt sur la mort et la défaite de ses héros et qui rappelle l’isolement du peuple juif, alors qu’Israël n’aspire qu’à retrouver sa place parmi les nations et se percevoir comme puissant et non victime. C’est la prise de conscience du cataclysme de la Shoah qui modifie encore une fois la perspective, faisant de Massada une préfiguration de l’extermination des Juifs d’Europe au XXe siècle. Aujourd’hui, la forteresse qui domine la mer Morte a retrouvé une place médiane, entre sa valeur archéologique et la reprise de l’histoire du peuple juif sur sa terre.
L’indépendance d’Israël
Pour Ben Gourion, la création de l’Etat d’Israël était un événement de portée messianique, comparable à des épisodes bibliques, qu’il inscrivait d’ailleurs dans la continuité de la sortie d’Egypte. Pour en justifier l’importance et la centralité, il l’a reliée directement à la période préexilique, gommant au passage toute la tradition diasporique. Israël redevenait un élément dominant à dimension rédemptrice. En recouvrant la souveraineté, le peuple juif réalisait son aspiration à la liberté et l’Etat devenait le garant de l’unité nationale juive. Dans les premières années qui ont suivi l’indépendance, Israël était perçu comme une étape non seulement vers la rédemption juive, mais vers la rédemption universelle, pour un Etat qui se devait d’être aussi la Lumière des Nations.
Ce n’est que progressivement que la dimension religieuse traditionnelle a pris une place dans la perception collective, même si elle l’avait été dès le début pour les sionistes religieux et en particulier pour le rav Tsvi Yehuda Kook.
La Shoah
C’est d’abord avec réticence que les Israéliens des premières années de l’Etat ont considéré la tragédie des Juifs d’Europe. Leur extermination dans des proportions inconcevables ne pouvait signifier qu’une chose : la faiblesse du Juif diasporique qui s’est « laissé mener comme un mouton à l’abattoir », sans réagir, ni se battre. Les rescapés qui arrivaient en Israël à la fin des années 40 devaient se faire oublier et se préoccuper d’abord de devenir des Israéliens et sortir de leur statut victimaire, incompatible avec l’image que la société voulait se donner d’elle-même.
Mais ce barrage était dérisoire face à l’ampleur de l’événement. Israël ne pouvait non plus s’amputer indéfiniment de sa part diasporique s’il voulait asseoir sa légitimité. En prenant la mesure de l’abomination, les sionistes ont aussi commencé à comprendre que leur vision universaliste de l’Etat d’Israël se heurtait à la réalité. L’étatisme de Ben Gourion voulait projeter une image de force et de confiance en soi, de victoire et d’égalité avec les autres nations.
Si la création de l’Etat d’Israël n’est pas la conséquence de la Shoah, sa reconnaissance internationale en a certainement été accélérée. Même alors, l’Israël de Ben Gourion refusait d’y voir un phénomène unique, mais seulement l’effet de l’exil et voulait rompre avec cette destinée de persécution du peuple juif.
La réflexion a évolué au cours des années 50, mais en mettant encore en exergue les actes de résistance et d’héroïsme plus que les victimes. Il a fallu ensuite se résoudre à intégrer la dimension du massacre, que les rescapés ont commencé à révéler à leurs compatriotes, mais aussi parce que l’unicité de la Shoah allait échapper à Israël. Le procès Eichmann et la création du Mémorial de Yad Vashem ont contribué à donner une place à la Shoah dans la mythologie israélienne. Elle rétablit la continuité et le lien historique entre l’Etat et la diaspora, lui confère une dimension de responsabilité transnationale et lui ajoute un statut de refuge ultime. Selon une enquête réalisée en 2017 par l’Institute for Zionist Strategies, 48% des Israéliens estiment que le premier rôle de l’Etat d’Israël est d’offrir un abri sûr pour le peuple juif.
Les lieux identitaires
La notion de site sacré a évolué dans la définition de l’identité israélienne. Massada, on l’a vu, a connu des fluctuations dans la perception collective. On ne détaillera pas ici la longue liste des sites dits « d’héritage », inventoriés comme tels par l’Etat et placés sous la tutelle du Conseil pour la préservation des sites d’héritage d’Israël. Ils sont ouverts au public et leur visite est inscrite dans les programmes éducatifs des établissements scolaires et de l’armée. Il s’agit essentiellement de sites bibliques ou liés à l’histoire contemporaine d’Israël. On choisira à titre d’exemple deux de ces lieux identitaires.
Tel Haï et Trumpeldor
Ce kibboutz du nord de la Galilée fut le théâtre d’un combat particulièrement meurtrier. En 1920, lors des émeutes arabes, Tel Haï, attaqué comme d’autres communautés de la région, fut défendu par un petit détachement de volontaires conduit par Yossef Trumpeldor. Après une bataille désespérée qui avait fait huit tués, submergés par les assaillants, les survivants ont dû abandonner le kibboutz. Avant de succomber, les derniers mots de Trumpeldor furent : « il est bon de mourir pour notre pays ». Son histoire s’est alors confondue avec celle de Tel Haï, qui devint un symbole, plus pour les sionistes révisionnistes qui y voyaient l’exaltation du sacrifice, là où les socialistes préféraient oublier la défaite et l’abandon. Le mouvement du Beitar est d’ailleurs l’acronyme d’Alliance Yossef Trumpeldor. Ce n’est qu’après l’indépendance que Tel Haï a pris sa place parmi les sites nationaux, même s’il reste aujourd’hui plus identifié avec la droite israélienne.
Le Kotel
Le mur occidental d’enceinte du Temple de Jérusalem est certainement le site le plus identifié à Israël et celui qui bénéficie de la plus forte notoriété. Symbole par excellence du lien entre l’histoire préexilique et le sionisme, il représente pour la société israélienne l’expression de sa permanence juive et de sa souveraineté recouvrée. La célèbre photo de David Rubinger des trois parachutistes devant le Mur, lors de la conquête de la vieille ville en juin 1967 a traduit le lien des citoyens juifs avec le site sacré du judaïsme, sans considération de leur niveau ou leur absence de pratique religieuse. Depuis une dizaine d’années toutefois, la perception du Kotel comme lieu consensuel est en train de régresser, principalement à cause du rôle des ultra-orthodoxes qui se le sont progressivement accaparé, au point d’en dicter les règles de visite et de prière. Si les hommes et les femmes y ont rapidement été séparés, ces dernières sont de plus en plus surveillées et rappelées à l’ordre quand leur tenue n’est pas jugée assez « modeste ». Sans parler de la polémique entre orthodoxes et réformés, qui ont de plus en plus de mal à y prier selon leur rite. Une controverse qui touche surtout au cœur des relations entre Israël et les Juifs de diaspora, principalement d’Amérique du Nord.
Le panthéon en mutation
Une collectivité a besoin de personnages héroïques autour desquels se fédérer et à qui attribuer les valeurs et vertus qui doivent la définir. Israël a puisé dans la Bible et dans son histoire contemporaine pour constituer un panthéon qui n’a pas encore acquis son statut définitif.
Herzl, le visionnaire : seule figure totalement diasporique à avoir obtenu son entrée permanente dans la catégorie des héros modernes d’Israël, l’auteur de « l’Etat des Juifs » a vu son prénom hébraïsé de Théodore en Benyamin Zeev. Ses cendres ont été rapatriées en Israël en 1949 et inhumées à Jérusalem sur une colline qui porte désormais son nom. Le Mont Herzl est devenu un site national, lieu des cérémonies les plus importantes et aussi de sépulture des principales personnalités de l’histoire de l’Etat. Herzl est à ce jour la figure la plus consensuelle du panthéon israélien.
Ben Gourion, le Moïse des temps modernes : le premier chef du gouvernement israélien et leader du mouvement sioniste est le personnage central de l’histoire moderne de l’Etat. Si David Ben Gourion était avant tout un leader politique, et en cela controversé et au cœur du débat public, son charisme était indéniable. Sa voix est indissociable, dans la mémoire des Israéliens, de la proclamation de l’indépendance d’Israël, le 14 mai 1948, dont l’enregistrement radiophonique est encore diffusé régulièrement. Porté par la ferveur du peuple, il était devenu l’incarnation du miracle de l’indépendance, au point que des nouveaux immigrants qui l’approchaient pour la première fois, le comparaient à « Moïse ». Si son positionnement idéologique continue à être discuté et analysé, son statut de héros d’Israël ne fait pas débat.
Ilan Ramon, l’Icare hébreu : l’ancien pilote de chasse de Tsahal fut aussi le premier astronaute israélien. Figure emblématique du Sabra, Israélien moderne mais attaché aux traditions et à l’esprit national, il était un exemple de la réussite et de l’audace propres à inspirer des sentiments de fierté. Ilan Ramon avait commandé l’escadrille qui avait bombardé en 1981 le réacteur nucléaire d’Osirak en Irak, considérée comme une des missions les plus audacieuses de Tsahal. Sélectionné pour être le premier astronaute israélien à participer au programme spatial de la Nasa, il avait péri en 2003 dans l’explosion de la navette Columbia à son retour dans l’atmosphère. Les circonstances de sa mort ont parachevé sa stature héroïque.
Ceux qui entrent et sortent : Menahem Begin, premier chef de gouvernement Likoud et ancien chef de l’Irgoun, est une des figures qui prend une place de plus en plus prépondérante dans le panthéon israélien. Longtemps vu comme le rival politique de David Ben Gourion, Begin est devenu une personnalité consensuelle et non plus partisane. La signature de la paix avec l’Egypte, sa proximité avec le peuple dont il a cherché à réunir tous les courants et toutes les composantes, l’ont hissé au rang de héros.
Par comparaison, d’autres personnalités politiques des premières décennies de l’Etat, telles que Golda Meir ou Moshe Dayan ont vu au fil des années leur cote héroïque baisser auprès du public israélien pour rejoindre plutôt la galerie des personnages historiques.
Même sort encore ambigu pour Itzhak Rabin ou Shimon Peres. Le Premier ministre assassiné en 1995 par un extrémiste juif reste une figure tragique, mais pas réellement fédératrice, en dépit de ses succès militaires. Il reste encore identifié aux divisions qui avaient traversé la société israélienne lors de la signature des accords avec l’OLP. Shimon Peres lui aussi, reste toujours à l’extérieur du panthéon israélien. Son mandat réussi de président de l’Etat n’a pas suffi à faire oublier les manœuvres politiques de celui qui n’était jamais parvenu à gagner une élection.
La conscience collective israélienne est constamment à la recherche de symboles et de signes fédérateurs. Toutefois, l’évolution permanente de la société et des rapports entre ses différentes composantes fait que ses mythes, comme ses héros, sont encore en construction. La religion civile d’Israël, de plus en plus pénétrée de la tradition juive qu’elle avait rejetée à ses débuts, devrait encore changer de visage, jusqu’à donner des réponses satisfaisantes à une société plus individualiste, mais toujours en quête de sens et de continuité.