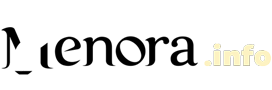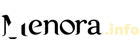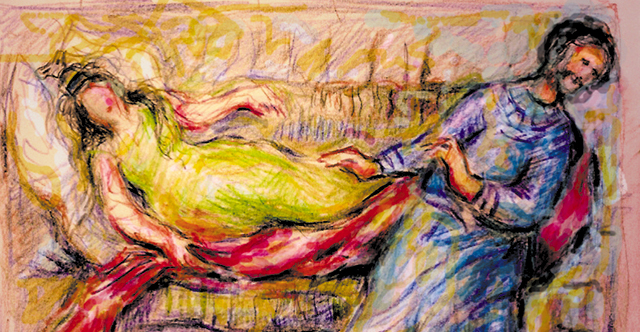Essayant d’achever un ouvrage de critique littéraire concernant les « Anticipations littéraires du terrorisme [contemporain] », j’ai tenu à participer au colloque international, « Figures et figurations des terroristes : enjeux postcoloniaux », qui s’est déroulé les 23 et 24 mars à l’Université de Paris 3 (Sorbonne Nouvelle)[1]. Je ne ferai pas ici le compte-rendu, mais seulement la critique de cette manifestation qui privilégiait le point de vue des auteurs de fiction musulmans sur ce problème. Il y eut quelques moments forts, quand le talent des intervenants ne se limitait pas à de simples repérages thématiques— une tendance désormais coutumière dans les colloques français. Ma communication, sur L’Agent secret de Conrad, n’a pas été bien accueillie, sans doute en raison de mon point de vue sur la leçon de cet écrivain « visionnaire », qui assimile génialement le terrorisme le plus violent et les mutations sociales, ressenties aujourd’hui comme un progrès, notamment dans les milieux universitaires. N’importe, j’aurais pu néanmoins être rassuré par la relative mise à l’écart, dans ces communications, de la question juive. Relative seulement : un des communicants, intervenant sur le thème du terrorisme basque, ne se distinguait pas seulement par sa thématique. Citant longuement mais très librement Derrida, il prêtait à ce dernier l’idée du « terrorisme israélien ».
Cet hameçon basque fut dédaigné par l’assistance. Sans savoir si cette absence de réaction était une marque d’innocence ou d’approbation, j’ai préféré me taire. Plus problématique, le succès de deux chercheurs belges en binôme, dont le discours sur les « perdants radicaux », thème clef du récit d’un auteur allemand, tendait à sanctifier la réputation de ces perdants, avec la mise sur le même plan des terroristes de tout bord et de toute époque, unis dans une « souffrance » qui dépasse le cadre de l’idéologie comme celui de la religion. La question de l’islam fut d’ailleurs totalement exclue de toutes les interventions, même quand elles portaient sur des œuvres où le Coran a une certaine place. Cette ellipse est peut-être le révélateur de la secrète familiarité de ces universitaires, peu soucieux du sacré, avec l’image qu’ils se font de ces « frères » pitoyables que sont les terroristes. Si le non-dit obsédant sur l’islam est favorable à ce dernier, le non-dit moins absolu sur le judaïsme a un tout autre sens…
Le chantre basque est revenu à la charge, à propos du recours à Hannah Arendt, dans une communication associant les œuvres de deux écrivains arabes. A la « mollesse de l’humanisme » de Arendt, le casseur basque préférait les épigones français de la déconstruction, cités en rafale. Cette réaction aggravant à mes yeux le scandale de la perspective humanitaire ménagée sur le terrorisme, avec « l’inquiétude » dont souffrent leurs coreligionnaires ou la fragilité qui (selon le texte de cette communication) s’exprime dans leurs actes. Ces derniers révélant un « repli identitaire » qui apparente ses victimes à des entités diaphanes. De telles affirmations, qui me dispensent d’en souligner l’horreur ou la folie, esquivant la question des fondements culturels, pour ne pas dire religieux du terrorisme (même si la religion en question recouvre une entreprise politique, que peu de chercheurs reconnaissent comme telle).
Cette passe d’armes fut suivie par l’estocade finale : la déclaration, lancée lors des dernières discussions, que le sort des terroristes emprisonnés se rapprochait de celui des victimes d’Auschwitz ! Cette affirmation explosive germait sur le rapprochement superficiel, dans une communication, du best seller d’un écrivain musulman évoquant les affres d’un « intégriste malgré lui » et des poèmes gribouillés par un terroriste musulman prisonnier à Guantanamo, poèmes qui, larmoyait l’auteure de cette communication, ont subi l’infamie de la censure d’un pouvoir abusif… Les crimes du prisonnier étant gommés (autre censure ?) dans cette communication, vouée seulement à présenter le « poète » comme une victime de ce pouvoir militaire. Cette torsion du sens s’est répercutée dans l’assimilation, lors de la discussion, de l’expérience de ce criminel poète à ses heures et des victimes d’Auschwitz. Au-delà de ce renversement qui n’a ému personne (l’empathie du public allant au poète), on peut s’inquiéter de la mise sur le même plan du best seller inspiré par un humour suspect à maints égards (me semble-t-il) et des poèmes rédigés sur des gobelets de plastique. Même si ces poèmes valent en effet ce roman (j’en suis persuadé, sans les avoir lus), leur rapprochement est un exemple du dynamitage de la hiérarchie, effet de la déconstruction à tout va, qui engendre cette vision du terroriste comme une victime des camps de concentration.
Si déconstruction il y a, elle s’attache en effet à l’image, confirmée au fil du colloque, du « terroriste », terme qui, d’après toutes ces interventions, n’aurait de valeur qu’ « universelle », avec l’idée d’une « violence fondamentale et universelle ». Sans que personne se risquât à estimer le rôle inspirateur du désir mimétique (Girard ne fut jamais cité lors du colloque) dans le terrorisme islamique, et d’abord dans la culture musulmane, fondée sur le Coran, vaste système d’échos où s’anamorphosent les figures des deux Testaments (surtout l’Ancien). Il fut plutôt question de la métaphysique chinoise, et à propos de l’esthétique d’un Salman Rushdi.
Je ne me suis pas étonné de voir assimiler les terroristes, qualifiés d’humiliés, aux « anarchistes », aux « résistants »… Le « processus de radicalisation », dans une autre communication, s’est vu tiré vers l’idée d’un « régime de figuration esthétique » (qui appréhende ce processus). Mieux encore, l’action des terroristes relèverait de la « contre-culture » et d’un « travail sur les signes ». — Il est vrai que ces expressions concernaient non pas le terrorisme en lui-même, mais la dimension critique des œuvres de certains artistes du monde arabe évoquant le terrorisme. Mais ce dernier peut-il se réduire à un système de signes ? L’ingéniosité discutable des détournements effectués par ces artistes ou romanciers, n’est-elle d’ailleurs pas la commémoration de la mainmise culturelle dont résulte le Coran ? Il semble en effet que la ruse légendaire des musulmans, et jusqu’à leur aptitude au copier-coller, soit l’extension profane des pratiques littéraires mises en œuvre dans l’écriture du Coran, où se voient pulvérisés, souvent en dépit de la lettre, l’Ancien et le Nouveau Testaments.
Ces universitaires scient la branche sur laquelle ils sont assis, avec l’idée d’une « littérature en l’absence de mots » (autre formule proclamée dans une communication). Ce mépris du verbe accompagne celui du Verbe et de ses origines vétérotestamentaires. J’y vois une autre forme de terrorisme, aussi grave que l’idée du « fondamentalisme de Manhattan et de l’argent ». Cette association, vers la fin du colloque, visait une cible connue. Mais les Juifs sont moins menacés ici que les valeurs incarnées par leur peuple et qui, au-delà du judaïsme, sont universelles.
J’ai néanmoins apprécié les reflets fugitifs de ces valeurs dans l’esprit de quelques-uns des collègues présents à ce colloque. Une communication résolument comparatiste n’avait pas d’autre intérêt que celui d’une analyse superficielle du contenu de trois récits. Pourtant son auteure fut la seule à réagir vertement à la vision paternaliste, imposée dans une discussion, des jeunes-défavorisés-des-banlieues… Son cri n’a pas trouvé d’échos. Même si l’intelligence et l’ouverture d’esprit ne manquaient pas dans l’atmosphère du colloque, et d’abord chez ses organisateurs. Mais pas au point que je sentisse la possibilité d’exprimer mon point de vue sans le risque d’inutiles remous[2].
[1] La publication des Actes n’est encore qu’envisagée. Mais l’ensemble de la manifestation a fait l’objet d’un enregistrement susceptible d’être diffusé.
[2] Je ne suis pas un lâche. Mais en 2016, lors d’une réunion des spécialistes de Victor Hugo à l’Université Paris-Diderot, j’ai tiré une leçon de la réaction du public, lors de la présentation de mon ouvrage Ecrire selon la rose, à la mise en avant de la shekhina (c’est ma thèse) pour éclairer le sens poétique du « sanhédrin » dans Han d’Islande, roman de jeunesse d’Hugo. Je frémis encore de l’irritation des spécialistes, plus familiers de Marx que de la kabbale, parmi lesquels j’ai eu au moins le bonheur de tenir un peu le rôle du héros éponyme de L’Homme qui rit, aux prises avec les Lords pervers.