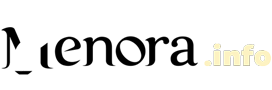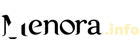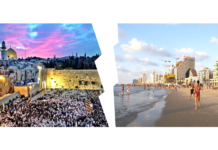Les ultra-orthodoxes qui quittent leur communauté redeviennent d’abord des individus isolés. L’Etat commence à les prendre en considération, mais ce sont surtout des associations qui leur viennent en aide, quand ils n’ont plus sur qui compter.
Le Bureau Central des Statistiques estime qu’entre 2007 et 2012, environ 12 300 personnes ont quitté le monde harédi. Pour elles, c’est un aller simple vers un monde dont elles ignorent tout et auquel elles n’ont pas été préparées. En hébreu, on les appelle « ceux qui retournent à la question ». Ce sont d’ailleurs différentes interrogations qui peuvent les conduire à rompre avec leur milieu. Ceux qui remettent leur foi en question, ceux qui critiquent la société harédite au point de ne plus s’y sentir à leur place, ceux qui aspirent à fixer personnellement le cours de leur vie et leur destin.
Mais pour tous ceux-là, il n’y a ni feuille de route, ni retour en arrière. Pourtant, peu à peu, la dynamique propre à la société israélienne prend le relais. Quand un seuil critique démographique est atteint et qu’un nouveau groupe social se forme, il créée ses propres instruments et codes d’identification. Cela commence par les associations, encore peu nombreuses et de formation récente, qui viennent encadrer et guider ceux qui ont quitté le monde harédi. Il faut d’abord trouver un hébergement d’urgence à ceux qui se retrouvent littéralement à la rue. L’association Hillel a ouvert pour eux deux centres d’hébergement d’urgence, à Jérusalem et à Tel Aviv, où elle accueille les nouveaux arrivants pour une durée de trois mois, et dispose de quatre appartements où les résidents peuvent passer jusqu’à une année. Depuis 2015, le ministère des Affaires sociales prend en charge une partie de leur financement, ainsi que celui de cellules de soutien psychologique et d’aide à l’emploi. Mais les moyens disponibles sont encore insuffisants.
D’autres organisations, comme l’association Yotsim Lechinouï, mettent à la disposition des anciens harédis des forums de soutien et de conseil qui les aident à faire leur premiers pas dans un monde dont les codes leur sont encore inconnus. Il faut comprendre que cette population n’a la plupart du temps ni ressource, ni formation. Leurs familles ont rompu avec eux, leur ancien environnement social les a rejetés. Les années d’étude en yéchiva ne les ont pas formés à un métier, leur méconnaissance des matières profanes, leur ignorance des langues étrangères, et en particulier de l’anglais, les handicapent dans la recherche d’un emploi. Sans parler de leur situation militaire. Il est plus facile, ou en tout cas moins difficile de sauter le pas à l’âge de la conscription, de faire son service militaire et d’entrer ensuite dans la société civile. Le problème est plus complexe pour ceux qui n’ont pas répondu à l’appel à l’âge légal.
Il leur faut aussi tout réapprendre, depuis les rapports sociaux aux codes vestimentaires en passant par tous les aspects de la vie quotidienne moderne. Beaucoup de ces « anciens religieux » se retrouvent d’ailleurs souvent coincés entre deux mondes : l’univers harédi qu’ils ont abandonné et l’univers moderne dans lequel ils ne trouvent pas tous leur place. Ils ressentent l’incompréhension des laïcs qui regardent parfois leur ancienne vie comme une forme d’infirmité. Au point que ces ex-harédim sont devenus à leur tour un nouvel élément dans la mosaïque sociale israélienne. Parce qu’il faut avoir été harédi pour comprendre les questions que se pose un ancien harédi.