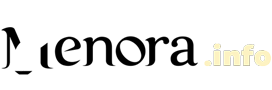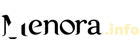Moi, c’est le loulou de Poméranie qui me faisait peur. Lorsqu’on entrait dans notre immeuble, sitôt montées les trois marches qui nous séparaient du palier, les aboiements furieux me faisaient reculer. Il fallait pourtant que j’aille au bout du couloir d’entrée, jusqu’aux escaliers, et gagner sur les hauteurs notre appartement. Sauf que la porte de l’endroit où habitait ce chien était juste en face de l’ascenseur. Alors là c’était le déchaînement. Jappements et hurlements du loulou qui se jetait contre le bois. Ma terreur était que Madame Picard ouvre sa porte pour nous saluer et que le chien se jette à mordre. Les chiens chez nous n’étaient pas commodes. Dans toutes les rues où erraient les molosses, Galoufa les traquait avec sa gaffe pour les mener à la fourrière. Un étage en dessous, les Spinosi avaient un couple de fox-terriers élevés à la ferme et dressés à attaquer les Arabes – disaient leurs maîtres, qui en avaient grand peur −, mais un jour que l’un d’eux s’était échappé, il avait mordu la mère Corot aux fesses alors que, dressée sur ses talons, elle ouvrait sa boîte aux lettres. Certes, elle avait crié en moulinant des bras et la maîtresse du cabot était accourue : « Vous allez me payer une nouvelle culotte », voilà ce qu’avait dit la voisine vilainement offensée.
Madame Picard n’avait pas eu d’enfants avec son mari, qui était spécialiste de la langue berbère à la Faculté. Que de fois avions-nous vu passer dans le hall d’entrée d’imposants cheikhs et chefs de tribu tout enturbannés, qui venaient éclairer le savant sur leur parler des Aurès et de Grande Kabylie ! Lui, le professeur, à grands éclats rauques, enregistrait les mots et les phrases dont il allait faire un dictionnaire de la langue des plus anciens indigènes de ce pays, les Imazighen, ces « hommes libres » qui furent sujets de la Kahena et lointainement juifs. Papa, qui avait appris le chleuh en son jeune temps, au Maroc, échangeait parfois avec lui quelques phrases étranges. En 1948, André Picard, qui n’était au départ qu’un modeste instituteur de bled, publia ses Éléments de grammaire berbère, Kabylie-Irdjen. Il avait attendu pour cela que la guerre fût terminée. Mais moi je prends ce fil de mémoire au tout début des années quarante, quand nous étions en inquiétude, et même en grande angoisse, sous la botte vichyssoise au cuir hitlérien.
J’ai toujours eu, tout gosse, une oreille qui traînait, et c’est elle qui alimente ma mémoire. Je sais encore que je voyais tout, j’entendais tout. Que s’était-il passé? Bien sûr, papa, après la promulgation, le 7 octobre 1940, des lois de Vichy sur le statut des Juifs en Algérie et l’abrogation du décret Crémieux, avait été convoqué au commissariat pour décliner sa qualité de Juif indigène, précédemment de nationalité française. Cependant, les états de service de celui qui fut militaire de carrière et avait collectionné les médailles sur divers champs de bataille, de surcroît mutilé de guerre et chevalier de la Légion d’honneur, l’avaient remis, et nous avec lui, en selle franque. Après deux semaines d’opprobre, voilà que nous étions à nouveau français. Nous ne fûmes pas chassés des écoles. Bien que montrés du doigt par tous ceux que notre présence indisposait. « Youpin » résonnait sur tous les murs de la ville et au préau de l’école. À la communale, que de fois Bony, l’écume aux lèvres, l’insulte en bouche, tentait de m’abattre, mais Vautrin, plus fort que lui, le rossait toujours en détournant ses poings. Vautrin était mon protecteur, comment oublier son nom – et bientôt ma lecture de Balzac ? Plus tard, Gilbert Mesguich, qui me gagnait de deux ans et était, pour cela, le cancre de la classe (lui aussi demeuré sur les bancs de la communale, car son père était pupille de la nation), m’apprit quelques calbotes (on disait comme ça) pour me défendre et déjouer les frappes antisémites. Bien avant Zidane, nous savions ce qu’était le coup de tête en pleine poire.
L’immeuble où nous habitions était un Foyer des Mutilés, habité exclusivement par les anciens combattants, leurs veuves ou leurs enfants orphelins de guerre. Collectivement les voisins étaient pétainistes, certains mêmes Croix-de-feu, le béret de côté faisant foi. Sauf deux ou trois : la veuve Guérin, qui avait une bonne TSF, venait, certains soirs, chercher mon père et en grand secret voilà qu’ils écoutaient « Pon-pon-pon-ponnnn… Ici Londres… La France parle aux Français ». Et puis il y avait Madame Picard et son grand mari, avec, hélas, le loulou de Poméranie : un résistant ! La voisine du rez-de- chaussée avait dit un jour à ma mère, et mon oreille traînait par là, de préparer deux valises, une pour Estelle, ma sœur, et moi le petit dernier. Car elle savait comme nous le savions que les listes avaient déjà été établies par la préfecture d’Alger, recensant tous les Juifs du pays, qu’ils fussent français ou indigènes, prêts pour les convois. Oui, la déportation ne nous épargnerait pas – comme elle n’épargna pas les Juifs d’Algérie qui se trouvaient alors en Métropole et qui, au nombre de 1500 recensés par Serge Klarsfeld, finirent dans les camps et figurent au Mur (parmi eux un certain Albert Bensoussan, né à Aïn- Témouchent). Et cette sainte femme avait prévu de tout bonnement nous adopter. Puisqu’elle n’avait pas d’enfants et qu’elle nous aimait tant. Sauf que moi, je ne me risquais jamais chez elle, où je n’ai jamais pénétré, au grand jamais, empêché, entravé, paralysé par son cerbère aboyeur qui me faisait grand peur.
Par chance, le 8 novembre 1942, les Anglo-Américains – les Alliés – débarquent à Sidi-Ferruch, et nous sommes libérés. Grâce à la Résistance de 280 jeunes Juifs emmenés par José Aboulker, qui, en participant à l’opération Torch (oui, une lampe torche à la main, ils balisaient le chemin des dunes), permirent aux soldats acheminés par bateau et péniches de débarquement de poser les pieds sur le bon sable. Je n’ai pas vu maman rapatrier nos valises qui avaient été déposées à la garde du loulou. Moi, encore enfant, je fus vraiment soulagé – oui, un vrai grand ouf libérateur − en voyant Américains et Anglais dans nos rues distribuer chewing-gums et tablettes de chocolat. Et désormais, même si le chien jappait et hurlait derrière la porte du rez-de-chaussée, moi, je m’en battais l’œil, tout en pensant, après coup, au vu des images des déportés à la descente des trains pour la nuit et le brouillard encadrés par de terribles chiens loups hurleurs et carnassiers, que tout aurait pu être pire pour moi, pour nous, et que le petit loulou de madame Picard était, finalement, un bien gentil toutou.