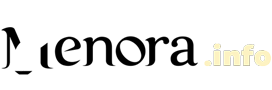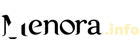Le « secteur » « sioniste religieux » constitue sans conteste le cadre social le plus intéressant de la société israélienne. C’est, sans aucun doute, parce qu’il est au carrefour des « laïcs » et « laïcistes », d’un côté, et des « religieux » et « ultra-orthodoxes » (Haredi) de l’autre. En somme: un marais, situé à distance des extrêmes, qui ne satisfait aux critères ni d’un côté ni de l’autre.
Il souffre, cependant, dès le départ, d’une faiblesse: il inscrit le judaïsme dans le sionisme politique sans s’être compté parmi ses fondateurs. À ce propos, l’enjeu n’est pas l’idée du retour à Sion qui est en question. Le judaïsme rabbinique l’a de tout temps portée en son sein, bien qu’il ait toujours freiné sa mise en œuvre politique, pourtant un aspect fondamental du messianisme juif.
Il ne faut cependant pas négliger néanmoins l’œuvre imposante et moderne du rabbin sépharade de Sarajevo, Yehuda Alkalai (1798-1878) qui promut de son temps un sionisme politique avant l’heure. Pour être plus précis: un sionisme politique qui ne s’éloignait pas du judaïsme au profit de la « normalisation »[1], sur le modèle de la « nation » des mouvements nationaux européens.
Le sionisme religieux fut en effet une tentative de prendre en marche le train du sionisme politique en lui rajoutant la dimension du judaïsme. Dès le départ, il fut donc en position d’équilibre précaire dans la société israélienne et le projet sioniste. En somme, il apportait au sionisme politique un supplément d’âme judaïque mais pas une refondation, parallèle à la « normalisation », fût-elle limitée au secteur sioniste religieux.
Ce dernier point est à souligner car le sionisme religieux avait en lui la possibilité d’ouvrir un horizon nouveau et global du retour à Sion et il s’est retrouvé enfermé dans un « secteur », d’autant plus flou et faible qu’il porte l’ambition de quelque chose de bien plus grand. C’est la source pour lui de toutes sortes de contradictions et de faiblesses constitutives. Se tenant à ce carrefour idéologique, il est inéluctablement soumis à deux pressions: la version « dure » du sionisme religieux, les sionistes ultra-orthodoxes (Hardalim), et la relativisation des mœurs laïques, ce qui donne lieu à des évolutions erratiques sur bien des problèmes de société auxquels les sionistes religieux sont confrontés parce qu’ils ne sont pas enfermés totalement dans la citadelle d’un migzar (secteur) et parce qu’ils portent en eux les vestiges du Am Israël dans la normalisation.
Force est de constater, de ce point de vue, qu’aucune grande vision du Am Israël dans la nation israélienne[2] ne s’est levée parmi eux, qui aurait aidé à repenser le projet sioniste sur le plan de la culture, de l’identité, de la vision. Elle aurait dû et pu s’y élever, d’autant que le choc de la victoire de 1967, réintégrant les territoires historiques du Am Israël, lançait un nouveau défi au projet de normalisation du sionisme politique, confronté malgré lui à 30 siècles d’histoire qui ébranlaient son projet limité dont le but était de trouver une place pour le peuple juif dans les cadres étriqués (pour les Juifs) de la modernité de l’auto-émancipation, alors qu’ici le peuple juif se voyait obligé impérativement à se mesurer à l’éternité d’Israël, à l’héritage biblique.
Ce défi ne fut pas relevé par l’Israël « normal, ni par les sionistes religieux d’alors, le Parti National Religieux (Mizrahi). Il y a une scène fascinante de vérité à ce propos. Quand Moshe Dayan se retrouva face au Mont du Temple, libéré de l’occupation jordanienne datant de la guerre d’indépendance, il s’exclama « qu’allons-nous faire de tout ce Vatican-là? » Et il remit les clefs du Mont au Waqf (administration musulmane) qui n’en espérait pas tant. Tout culte juif fut interdit sur le Mont du Temple, considéré comme un espace « historique » pour les Juifs et « religieux » pour les musulmans, tandis que seul le Mur occidental fut transformé en lieu de culte (qui avait été souillé et interdit d’accès aux Juifs sous les Jordaniens). les ministres du parti national religieux, les sionistes religieux d’alors, s’alignèrent sur cette décision, ébranlés par cette nouvelle troublante: Jérusalem était revenue dans le giron du peuple juif, incapables de faire face à ce défi gigantesque du fait de leurs faibles moyens sur le plan de la conscience de la souveraineté, celle d’un peuple juif et pas d’un camp humanitaire pour rescapés de l’antisémitisme.
Dès ce moment, le sionisme religieux montra qu’il n’était pas à la hauteur de lui-même. Les habits étriqués qu’il portait ne lui permettaient pas de grandir. Cela se traduisit par la naissance réactive d’un autre phénomène, le Goush Emounim, qui versa dans un activisme compensateur, en forçant le rapprochement avec une version plus « dure » du judaïsme, l’ultra orthodoxie, ce qui donna naissance à un mouvement conjuguant la dimension nationale – à la façon du sionisme politique – et le judaïsme, sans pour autant que ces deux composantes aient fait l’objet d’une réappréciation du point de vue de la doctrine du judaïsme rabbinique elle-même.
C’est là la faiblesse fondamentale de toute cette mouvance. Elle est en retard d’une pensée de la souveraineté (et du rapport à la terre) qui s’abreuverait aux sources mêmes du judaïsme. C’est là tout le problème, car le judaïsme rabbinique, héritier de 25 siècles de galouth (exil) et de dépendance, est en panne d’une vision politique globale à la mesure du Am Israël et surtout de la nouveauté extraordinaire qu’est la souveraineté nationale et politique, dont le sionisme politique fut l’artisan mais qui ne put, ni ne sut , inclure la dimension métapolitique qui le porte en réalité (j’inclus dans la « réalité » l’imaginaire social et les mythes collectifs, et donc la « religion »).
[1] Ce qui définit le sionisme du monde sépharade
[2] Je pose ici deux formes de collectifs juifs différents dont l’idéaltype est caractérisé. Cf. S. Trigano, Politique du peuple juif. Editions JC Bourin, et Le nouvel Etat juif, Berg international, en hébreu Hamedina hayehoudit meever le normaliout, Ed. Carmel