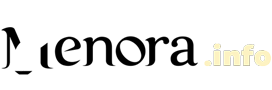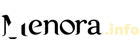Voici près de deux ans, le ministre israélien de l’Education Naftali Benett a nommé Erez Bitton, prix Israël de poésie, à la tête d’une commission chargée de présenter un rapport contenant des propositions concrètes visant à mettre en valeur la contribution de la composante séfarade et orientale dans l’histoire et la culture de l’Israël contemporain. Avoir pris conscience de cette absence ou plus précisément de cette occultation, quelque soixante-dix ans après la création de l’Etat, en dit déjà long sur la façon inconvenante, lacunaire et tendancieuse dont on écrivait l’histoire et dont on enseignait la littérature. Le grand récit est devenu peu crédible. En un mot, on a éduqué des générations en les gavant d’une histoire écrite et conçue d’en haut, d’un récit ethnocentré qui faisait la part belle aux œuvres d’une seule composante du peuple : l’ashkénaze. Et qui n’a pas rendu compte du sort et de la contribution des Juifs provenant des pays arabes. Ce qui a provoqué une distorsion idéologique de l’histoire et de la littérature. Ce n’est certes pas la première fois qu’un rapport de la sorte est initié. Jusqu’à présent les propositions restaient sans suite et les dossiers allaient grossir les archives. Avec le rapport Bitton, il semble qu’on assiste à un frémissement. Un espoir est né. Il conviendra de l’évaluer le moment venu.
Travaillant d’arrache-pied, la Commission a présenté son rapport au Ministre. Rapport rédigé en trois grandes parties dont les deux premières proposent d’introduire des changements dans deux disciplines d’enseignement : l’histoire (p.1 à p.78) et la littérature (p.79 à p.184) ; la troisième évoque l’écho des consultations publiques : des personnalités triées hélas selon leurs origines émettent un avis sur cette initiative ou évoquent leur expérience et leur contribution (p.233 à 360). C’est peu de dire que cela a provoqué des réactions épidermiques de la part de ceux qui se croient les détenteurs officiels et exclusifs de la culture israélienne. Pourtant, ils ne se sont pas contenté d’en critiquer tel ou tel point, mais ont ressenti le besoin impérieux de demander le retrait du projet et de donner libre cours à la haine vis-à-vis d’un courant majeur, important et constitutif du peuple juif. Alors, sous prétexte de critiquer les propositions du Rapport Bitton, l’on a assisté, en fait, à une tentative de délégitimation de la culture séfarade et orientale en arguant que c’est une culture mineure ou tribale, plus encore : une non-culture, « une culture des cavernes », disait Nathan Zakh.
La littérature pense
Il est indubitable que les membres de la sous-commission littérature ont fait un travail de fourmis : précis et rigoureux avec des propositions très explicites et dûment référencées pour chaque classe du primaire et du secondaire pour les réseaux du mamlakhti : laïc et du mamlakhti-dati : religieux. Toutefois, si les propositions sont bien présentes, il manque, à mon humble avis, l’audace qui ne consiste pas seulement à demander un pourcentage supplémentaire d’auteurs et d’œuvres séfarades, mais de coupler cette exigence légitime à une réforme structurelle. Oser plus, puisque le moment semble propice. Pour ce faire, il importe de mettre en avant les présupposés théoriques sur lesquelles on fonde les choix afin d’enseigner la littérature séfarade sous toutes ses modalités : romans, poèmes, essais, biographies, non pas comme une sous-catégorie de la littérature générale mais comme la partenaire à part entière. On peut même introduire cette notion dans les grandes classes du secondaire par des études comparatives…
Identification
Car la littérature pense et fait penser. L’écriture littéraire et poétique est d’essence testimoniale. Elle témoigne pour le témoin et donc permet l’identification aux personnages et aux auteurs. Qui d’entre nous n’a pas été bouleversé par une œuvre littéraire. Des personnages comme le Docteur Rioux, héros de La peste ou par Meursault – ce héros négatif, dont le nom est un néologisme qui combine la mer et le soleil d’Algérie, si présents dans le roman d’Albert Camus ou par le Roquentin de La nausée de Sartre ou encore par Téhila d’Agnon, ou enfin par Don Quichotte et Sancho Pansa de Cervantès ou par Qinat haméhager : La lamentation de l’immigré de Moïse (Moshé) ben Harrosh[1] ? C’est qu’une des fonctions assurées par le roman ou le poème est de tenir lieu de sociologie comme le faisaient, au 19è siècle, Balzac et Zola. Et parfois un roman peut changer une vie, tant l’identification peut être prégnante. C’est cette identification avec les héros qu’il convient de rechercher afin de rendre la dignité aux membres de la composante séfarade-orientale de la société israélienne. Mais il faut prendre garde, s’agissant d’Israël, que la petite voix des récits bibliques ne se perde pas dans le vacarme et la publication à outrance du tout-venant de bonne et de mauvaise qualité, surtout qu’elle se fait ici quasiment à fonds propres. Car alors comment ne pas être affecté par le récit de la ligature d’Isaac ou par Rivka, la mère de Jacob et d’Esaü ou par Hannah, la mère de Samuel ? « Admettre l’action de la littérature sur les hommes, c’est peut-être l’ultime sagesse de l’Occident où le peuple de la Bible se reconnaîtra[2]. » Oui, la littérature forme jusqu’à la conscience éthique et politique du citoyen. Elle lui donne les outils conceptuels pour participer aux débats qui agitent la société. Elle fait appel à sa raison mais aussi à son affectivité.
C’est que l’œuvre se réfère à une émotion qui a disparu comme émotion mais que l’auteur tente de préserver dans son écrit. De lui donner forme. Dans les romans historiques, il y a un entrecroisement de l’histoire et de la fiction. Et on peut alors lire l’histoire comme on lit un roman.
Un roman, un poème, une biographie, un essai sont l’expression d’une capacité pour l’œuvre de restructurer le monde du lecteur en bousculant ou en remodelant ses attentes. Si c’est une œuvre digne de ce nom elle consiste à restructurer le monde du lecteur en le confrontant au monde de l’œuvre. De sorte que le lecteur puisse habiter ce monde, le rendre hospitalier à la fois pour lui et pour son prochain…
Identité narrative
Mais la littérature forge aussi une identité narrative. « Dire l’identité d’un individu ou d’une communauté, écrit Paul Ricœur, c’est répondre à la question : qui a fait telle action, qui en est l’agent, l’auteur ? Il est d’abord répondu à cette question en nommant quelqu’un, c’est-à-dire en le désignant par un nom propre. Mais quel est le support de la permanence du nom propre ? La réponse ne peut-être que narrative. C’est l’histoire d’une vie[3] ». La noble fonction des écrivains, poètes et historiens est de raconter la vie non seulement d’individus mais d’une ou de plusieurs entités collectives particulières qui méritent d’être érigées au rang de quasi-personnages. Et de la graver, de l’encrypter, de l’enchevêtrer dans le grand récit du peuple juif. Car la narrativité n’est pas dénuée de toute modalité normative ou prescriptive.
Ce sont ces quelques réflexions qui m’ont manquées à la lecture de ce rapport dont, une fois encore, il convient de souligner l’importance et l’impact. Il reste à espérer que les propositions de modification des programmes soient mises en place au plus vite, car il y va de la condition sine qua non de notre bien vivre-ensemble dans ce pays.
[1] Avec comme sous-titre, Autoportrait du poète dans le contexte familial, Ed. Yaron Golan, collection poésie, Tel-Aviv, 1994. Long, très long poème où l’on trouve cette réflexion « Les ashkénazes veulent de l’action/ Ils désirent des séfarades subjugués, nostalgiques/ de coucous, de dafina ou de ma’abara*/ et non pas de séfarades qui écrivent des poèmes philosophiques/ Non, nous n’y consentirons pas, c’est notre chasse gardée, que pensent-ils, ces gueux/ Assis, au coin», p.88-89 [*villages de tentes insalubres où l’on parquait les olim]
[2] Emmanuel Levinas, Difficile Liberté. Essais sur le judaïsme, Albin Michel, Paris, 1963, collection Présences du judaïsme, p.77
[3] Temps et Récit, 3. Le temps raconté, Seuil, Paris, 1985, collection Points Essais, p. 442. Je souligne.