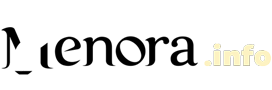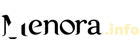La question de savoir si les Juifs originaires de France constituent un « secteur » dans la société israélienne se pose concrètement et symboliquement. Il faut savoir ce qu’est un « secteur » (migzar, un terme dont le radical signifie « découper ») pour le comprendre. On traduirait ce terme en français contemporain par « communauté », c’est à dire une collectivité se recommandant d’une identité secondaire au sein de l’identité israélienne (voire en rupture avec elle, comme pour les Arabes ou les ultra-orthodoxes), une collectivité vivant donc dans un certain recul par rapport à la norme courante, formulant de surcroît des revendications spécifiques envers l’Etat.
Comparés à d’autres « secteurs », la réponse est négative pour la communauté francophone. Aucune comparaison n’est possible avec le secteur « religieux », qu’il soit orthodoxe ou sioniste, ni avec le secteur russe, et d’autres.
Il faut comprendre les raisons structurelles de cet état de fait. L’origine française en est pour une part. Marqués par le modèle républicain (avant sa décomposition contemporaine), les Juifs français ont été accoutumés à vivre dans un univers non fragmenté, aligné sur une norme commune, incarnée par le centralisme étatique républicain, que ce soit en métropole ou en Algérie, excepté durant la période du régime de Vichy, qui décréta que les Juifs étaient un peuple étranger en France. Le trauma qui en résulta ébranla le modèle et explique pourquoi, au lendemain de la Shoah, les Juifs prirent en charge, pour la rédimer, leur condition collective face à l’Etat. On parla de « communauté juive », des institutions nouvelles, nées dans la Résistance, surgirent en guise de « représentation ». C’était la seule façon de réintégrer la citoyenneté (individuelle) en transcendant la défaillance qu’elle avait montrée sous Vichy.
Ce n’est qu’avec le Bicentenaire (1989) et la naissance d’un néo-républicanisme que la question du « communautarisme » juif fut posée comme un grief à l’égard de l’identité juive d’après-guerre. Cela se produisit dans le cadre du débat politiquement esquivé sur l’immigration originaire des Etats nord africains. Fustiger le « communautarisme » juif, c’était une façon détournée et « politiquement correcte » d’adresser la même critique aux immigrés, identifiés à une » communauté de l’immigration », dont on craignait la réaction, à travers les Juifs, dont ne craignait rien. Cette crise augurait, cependant, de la fin de la renaissance judéo-française d’après-guerre et constitua l’une des premières causes de l’immigration des Juifs français en Israël.
Immigrant en Israël, les Juifs français, du fait de ce passé, s’attendaient à y trouver un cadre collectif national, unique et, malgré tout, ouvert à une « petite musique » judéo-française dans l’intégration dans la société israélienne. Or, l’Etat d’Israël que ces immigrants découvrirent dans les deux mouvements d’alyah les plus importants en 1969 et en 2015, ne répondait pas à cette attente. En 1969, l’Etat ben-gourionien n’était déjà plus et, en 2015, le modèle multiculturaliste était à l’œuvre.
L’Etat ben-gourionien avait montré à l’expérience un avantage et un désavantage. Il s’était voulu centraliste, un peu à la française, en vertu d’une forme de républicanisme, la Mamlakhtiout (l’étatisme), et il avait adopté une politique du « melting-pot » éradiquant toute identité secondaire. Mais le modèle culturel qu’il imposait se révéla, à l’épreuve, marqué par une spécificité ethnique massive qui excluait naturellement de ses modèles une partie – en fait la majorité – de la population, à savoir la population sépharade (« les Marocains ») arrivée dans les années 1950. 1969 marqua de ce point de vue la brisure du consensus social concernant cette politique. Il apparut clairement qu’il y avait un « Second Israël »[1] qui ne trouvait pas sa place dans le pouvoir et le modèle culturel central. Le modèle ben-gourionien s’effondra donc. Dans ces années-là, à l’époque du Goush Emounim, les olim de France s’investirent beaucoup dans le secteur, à l’époque naissant, du sionisme religieux, notamment sous la houlette de Manitou.
Les immigrants de 2015 arrivèrent dans un tout autre pays. A la Mamlakhtiout avait succédé un multiculturalisme débridé dont tous nos dossiers rendent compte: une société organisée par communautés, un modèle qui, par ailleurs, guette aujourd’hui toutes les démocraties contemporaines. Sous ce jour, les notions consensuelles comme celles d’intégration, la klita, voient leur pertinence s’éroder: il n’y a plus de modèle unique auquel s’intégrer…
Arrivant dans ce paysage-là, les Juifs de France ne savent pas en fait à quel secteur se rattacher, ni s’ils constituent, eux-mêmes – un secteur. Ils ne collent pas totalement au secteur sioniste religieux ni au secteur laïque, ni au secteur sépharade orthodoxe, à moins qu’ils ne le soient à tous ces secteurs à la fois.
Il faut signaler à ce propos une caractéristique: à l’influence culturelle du moule républicain s’ajoute – et on rejoint ici une des caractéristiques du problème – l’héritage de la conscience sépharade qui, dans la fragmentation moderne, avait su sauvegarder l’unité de ses repères historiques et religieux et notamment le lien au « peuple juif » comme critère majeur de l’appartenance collective, là où le judaïsme ashkénaze connaissait l’éclatement de la synagogue. La montée en Israël s’est faite pour eux en direction d’un « peuple » juif, une catégorie devenue relative (caduque?) dans l’israélianité et qui avait traversé dans les années 1950 une crise objective. Remarquons qu’il n’y eut de « secteur » sépharade (le Shas ultra-orthodoxe) qu’avec les sépharades formés dans les yeshivot ashkénazes.
L’enchevêtrement de toutes ces situations explique le caractère indécidable de l’identité collective des Israéliens d’origine française (et majoritairement franco-israéliens) dans la paysage israélien d’aujourd’hui. Le carrefour identitaire auquel ils se trouvent peut conduire vers des voies nouvelles, s’ils trouvent les moyens de traduire dans les termes de la société et de la politique israéliennes l’enjeu auquel eux-mêmes sont confrontés. Il peut aussi s’effacer dans une périphérie sans nom.
[1] Cf. le dossier (sous ma direction) des Temps Modernes, « Le Second Israël », en mai 1979.