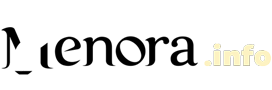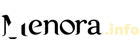Le sociologue israélien est devenu l’un des témoins engagés de la « contestation Balfour ». Sa voix est sollicitée par les jeunes contestataires sur les réseaux sociaux. Il y voit un mouvement profond, en évolution, mais sans véritable perspective.
Propos recueillis par Pascale Zonszain
Menora.info : La contestation Balfour a déjà plusieurs mois d’existence. Et pourtant, au-delà du slogan « Tout sauf Bibi », on ne voit toujours pas se former de contenu ni d’orientation clairs. Pourquoi ?
Lev Luis Grinberg : Pratiquement tous les groupes et les individus qui participent à ce mouvement ont des préoccupations différentes. Ce n’est pas qu’ils n’ont pas de contenu, mais plutôt qu’ils n’ont pas de contenu commun. La contestation s’est développée à partir d’un petit groupe de gens qui ont commencé à manifester il y a environ trois ans à Petah Tikva [manifestations près du domicile du Conseiller Juridique du Gouvernement pour réclamer l’inculpation du Premier ministre pour corruption, NDLR]. On en retrouve certains aujourd’hui à Balfour. Ce sont ceux qui considèrent que Netanyahou ne peut pas continuer à gouverner, alors qu’il fait l’objet d’une mise en examen. C’est la première vague de la contestation. Vient ensuite la deuxième vague, celle de groupes qui protestent contre l’instrumentalisation par Benyamin Netanyahou de l’épidémie de Covid pour se soustraire à la procédure judiciaire. Lors du premier confinement, l’état d’urgence sanitaire avait entrainé la fermeture des tribunaux. C’est ce qui a déclenché le mouvement des Drapeaux Noirs, pour qui de telles mesures mettaient la démocratie en péril. Après, est arrivée la troisième vague de contestation, celles des déçus de l’accord de coalition, quand le parti Bleu Blanc de Benny Gantz a accepté de rejoindre le gouvernement, contre sa promesse lors des trois échéances électorales de 2019 et 2020, de ne pas siéger avec un Premier ministre sous le coup d’une inculpation [le parti s’était scindé et environ la moitié de ses élus, emmenés par Yaïr Lapid est passée dans l’opposition, NDLR]. Dans cette troisième vague de contestation, ce sont les déçus de la politique israélienne, mais pas de la démocratie. Dans ce courant, on voit d’ailleurs apparaitre des gens plus jeunes qui ne s’étaient pas mobilisés au début. Leur ressenti est que les politiciens ne leur offrent aucun espoir dans l’avenir. Et il faut encore distinguer une quatrième vague, celle qui a suivi la sortie du premier confinement. Cette contestation vise les répercussions économiques de la crise sanitaire et le fait que le gouvernement n’indemnise pas les victimes de cette crise. C’est le mouvement des travailleurs indépendants, mais aussi de certains chômeurs. Et c’est à partir de là que la contestation est devenue massive. Quant au mot d’ordre « tout sauf Bibi » il reste celui dicté par les première et deuxième vagues de la contestation. Mais il est difficile de fédérer l’ensemble de ces doléances en un contenu unique. On a un lieu d’expression de mécontentement – Balfour -, près de la résidence du Premier ministre, qui est devenu une sorte de Hyde Park à l’israélienne.
C’est la situation sanitaire qui est le principal facteur de formation de la contestation, ou y a-t-il quelque chose de plus profond ?
Je pense qu’il y a une dualité de la démocratie israélienne. D’un côté, on a une totale liberté d’expression, et de l’autre la démocratie ne fonctionne pas. Et ce n’est pas à cause du Covid. Il y a des problèmes fondamentaux qui se sont exprimés de façon extrême. On a eu trois élections successives, dont les résultats n’ont pas abouti à une décision claire sur la formation d’un gouvernement. Ce blocage est un échec de la démocratie, alors pourtant qu’il pouvait se dégager une majorité au parlement contre Netanyahou. Et c’est à mon avis dû à la perception de la démocratie israélienne comme la démocratie des Juifs. Elle n’y associe pas les Arabes, dont les quinze mandats à la Knesset n’entrent pas en ligne de compte.
Mais les élus arabes israéliens eux-non plus ne sont pas prêts à entrer dans un gouvernement.
Mais ils étaient prêts à fournir un soutien extérieur, pour empêcher Netanyahou de réunir une coalition. C’est Gantz qui n’en a pas voulu. Le seul qui avait réussi à dépasser cette conception, c’était Itzhak Rabin. En 1992, il avait obtenu le soutien des partis arabes à l’extérieur de la coalition en leur offrant en échange un vrai programme de développement de leur secteur. Cela lui a coûté la vie. Parce que c’est aussi là-dessus, et pas seulement sur le processus de paix avec les Palestiniens, qu’on a voulu le délégitimer.
Qu’est-ce qui restera à votre avis de la contestation actuelle ?
En un mot : Rien ! (rires). Pour qu’elle ait un effet, il faut l’émergence d’un groupe de personnes capables de présenter le problème dans toute sa réalité et de proposer des solutions réelles. Cela peut advenir, mais pour l’instant je ne le vois pas. Ma spécialité, c’est l’étude des mouvements de protestation qui ont échoué à obtenir satisfaction à leurs revendications, mais qui obtiennent des résultats partiels ou différents de leurs objectifs. Pour ce qui concerne la contestation actuelle, on n’arrive pas à savoir clairement ce qu’elle veut. Si l’on regarde ce qui s’était passé avec la contestation de 2011, le résultat a été l’ascension politique de Yaïr Lapid [leader du parti laïc centriste Yesh Atid, NDLR]. Ce n’est pas cela qu’espéraient les contestataires de l’époque. Ce qu’ils attendaient c’était un Etat providence, une solution à leurs problèmes de logement, etc. Et c’est Lapid qui est venu et qui a raflé la mise. Est-ce qu’en 2020 aussi, quelqu’un va récupérer la contestation ? Pour l’instant en tout cas, il n’y a rien à voler, car il n’y a pas de contenu.