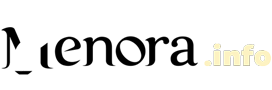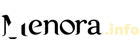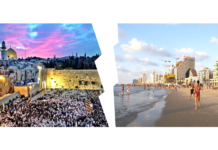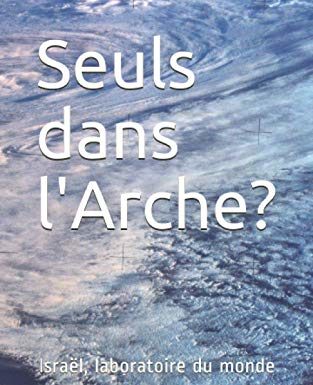La mémoire est un élément fort de la constitution de l’identité collective israélienne. Mais comme sa société, elle se privatise et subit aussi les effets d’une conjoncture culturelle mondiale de victimisation, constate l’universitaire israélien, spécialiste de la pensée sioniste.
Propos recueillis par Pascale Zonszain
Menora.info : Peut-on encore parler aujourd’hui d’une religion civile israélienne ?
Denis Charbit : Ce concept de religion civile, que le sociologue américain Robert Bellah avait employé pour caractériser la société américaine et l’ethos américain, a vocation à dégager, à discerner ce que l’on définirait dans le langage des Eclaireurs Israélites de France, comme un minimum commun ou un dénominateur commun à une société, qui d’emblée, assume sa diversité, ses contradictions. D’où la pertinence de l’importer et de voir dans quelle mesure il s’applique au cas israélien. C’est le sociologue israélien Charles Liebman qui l’avait repris à son compte pour essayer, toujours en assumant les différences et les clivages qui traversent la société israélienne – entre Juifs et Arabes, entre religieux et non-religieux, entre gauche et droite, classes populaires et élites – de dégager un dénominateur commun. Ce qui était dès le départ d’une portée partielle. Parce que la religion civile, pour rassembler tout le monde, ne peut être qu’israélienne, et que la seule chose que tout le monde a en commun c’est de disposer d’une carte d’identité et d’un passeport israéliens. Or, les tentatives de concrétiser ce terme de religion civile en l’appliquant à la société israélienne étaient en général circonscrites à la partie juive du pays. Et là aussi, il a été difficile de trouver un consensus.
Alors, quels ont été les éléments de ce consensus ?
J’en vois au moins deux. Le premier est cette notion de la Mamlach’tiout [étatisme, NDLR]. C’est la manière dont l’Etat ou le pouvoir d’Etat définit ses règles, plus d’ailleurs que leur contenu. Après une période où la société civile prenait tout en charge, ce concept de Mamlach’tiout est venu rappeler l’existence d’un service public, mais aussi d’un domaine public qui doit s’appliquer sans exception. Le deuxième élément de cette religion civile, de plus en plus, en tout cas depuis les cinquante dernières années, c’est la Journée de la commémoration de la Shoah. Etant entendu qu’après le procès Eichmann, après le film de Claude Lanzmann, la Shoah a été perçue comme l’événement le plus important du XXe siècle, précédant même en importance la création de l’Etat d’Israël. On pourrait encore bien sûr mentionner Tsahal comme élément de cette religion civile, à ceci près que l’on n’est plus dans un ensemble qui toucherait toute la population israélienne. Hormis les cérémonies mémorielles, j’ajouterais aussi toutes ces discussions qui sont très régulières, en particulier autour de la période de l’anniversaire de l’Indépendance, sur la « Israeliout » (l’israélianité). Qu’est-ce que c’est qu’être israélien ? Ce qui est intéressant, ce n’est pas de trouver le critère qui définisse l’israélianité de tous, mais le fait même de se poser la question. Et le fait, en permanence, de ne pas être satisfait des réponses qu’on y apporte. Cela correspond à mon avis, à ce sentiment très largement partagé que la société israélienne, née récemment, reste une société inachevée. Même si ce qui change un peu dans ces dernières années, c’est l’apparition d’une sorte de narcissisme de la réussite, là où auparavant, ce sentiment de satisfaction, qui a toujours été partagé, restait tempéré par la fragilité, par le sentiment de la survie. Ce qui est peut-être aussi lié au judaïsme, le sentiment d’être provisoire sur cette terre, de quelque chose qui n’était jamais complètement acquis, lié aussi à une population peu nombreuse, même si aujourd’hui Israël vient de passer le cap des 9 millions d’habitants.
Le sentiment de fragilité, de survie, que vous évoquez, n’est-il pas lié à la mémoire collective, à son rôle dans cette définition de l’identité ? La mémoire de la Shoah, la mémoire des guerres, celle de la fondation de l’Etat, est-ce que cela représenterait une sorte de mémoire de souffrance et de sacrifice qui fonderait la légitimité de l’indépendance de l’Etat ?
Effectivement, c’est une mémoire collective tournée vers la mort et le deuil. Je ne dirais pas que c’est le culte du martyr, parce que ce n’est pas du tout la même chose. Pourtant, si l’on prend par exemple la Journée de Rabin [Itzhak Rabin, Premier ministre israélien assassiné en 1995, NDLR], c’est pour commémorer la date de sa mort, alors que par comparaison, la Journée Kennedy aux Etats-Unis commémore le jour de la naissance du président américain assassiné. Il y a donc en Israël une inclination à cette mémoire de deuil. Mais il faut bien comprendre que cela joue aussi un rôle dans l’économie du conflit. On sait bien que dans la conjoncture culturelle mondiale, il faut être victime. On a donc cette propension. Les Palestiniens d’ailleurs, revendiquent cette place de victime. On peut donc penser aussi qu’au-delà de la commémoration pour elle-même – ne pas oublier d’où l’on vient, ce que l’on a vécu – il y a certainement aussi une sorte de compétition au sujet de qui est la victime ultime. Mais je pense que cela fait aussi partie de la culture juive de manière générale.
Parallèlement à la compétition victimaire que vous décrivez entre Israéliens et Palestiniens, n’y a-t-il pas aussi à l’intérieur même de la société israélienne une compétition mémorielle ? Toutes les mémoires n’ont pas une part égale, par exemple celle des Juifs orientaux, qui revendiquent toujours une vraie commémoration de leur expulsion des pays arabes. Là encore, n’y a-t-il pas quelque chose qui manque dans le dessin complet de l’identité israélienne ?
On est effectivement dans une concurrence des victimes, où chacun doit avoir sa part. Mais c’est également dû au fait que cette mémoire s’est beaucoup privatisée, qu’elle s’est communautarisée. Il y a cet effort de dire que les Juifs orientaux ont eux aussi participé au projet sioniste, qu’ils ont aussi été victimes de la Shoah – ceux de Salonique, de Tunisie et d’ailleurs. Mais cela me parait toujours un peu troublant. J’y vois un peu une remise en cause de ce qu’avait été quand même le point fort du sionisme, qui consiste d’abord à se prendre en charge, à aller de l’avant et ne pas être dans cet état d’esprit où les seuls galons à arborer seraient ceux de la victime que l’on a été. Il est vrai aussi que tout ce qui relève de la « Nation startup » procède d’une course en avant, mais cela se fait dans une sorte de narcissisme qui me gêne un peu. Bien sûr, je préfère me féliciter de succès que de ne chanter que des échecs et des défaites, même s’il y a une sorte de centralisation autour de nous, de nous seulement. Nous nous prenons un peu trop pour le nombril du monde. Il faut attribuer cela à une maladie de jeunesse, même si Israël a 71 ans !
Alors pour aller de l’avant, faut-il un consensus sur la mémoire ou se projeter dans une sorte d’utopie partagée ?
Ce qu’il y a de plus difficile aujourd’hui, c’est d’essayer d’écouter la souffrance d’un autre, sans avoir le sentiment d’être remis en question par elle. On n’est pas capable d’entendre la souffrance d’un Palestinien sans pointer son antisionisme. Même chose pour les Juifs orientaux, quand ils racontent comment ils sont arrivés dans les années 50 et 60 en Israël. Aussitôt, les Ashkénazes se défendent. Il faut être capable d’une attention. Comment développer l’attention de l’un à l’autre, sans avoir le sentiment que cette attention portée à une souffrance culpabilise celui qui l’écoute, qu’elle ferait de lui un bourreau. C’est valable pour tout le monde et je ne suis pas au-dessus de la mêlée. On en est encore loin, mais je pense que c’est la condition sine qua non pour bâtir, peut-être pas une utopie, mais cette religion civile pour Israël.