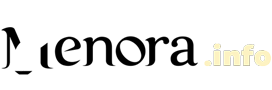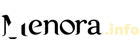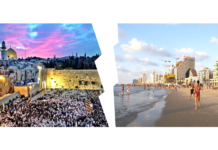Economiste au Bituah’ Leumi, la Caisse Nationale d’Assurance d’Israël, Jacques Bendelac suit donc au plus près l’évolution des inégalités sociales en Israël. Il analyse le phénomène de la nouvelle pauvreté que connait le pays depuis le début des années 2000 et ses prévisions ne sont pas optimistes.
Propos recueillis par Pascale Zonszain
Menora.info : Quelles sont les causes de la pauvreté en Israël ?
Jacques Bendelac : La pauvreté n’est pas un phénomène naturel. C’est le résultat d’une politique économique, d’une idéologie, d’une action gouvernementale, qui se répercutent sur la structure sociale. En Israël, la pauvreté augmente très fortement à partir de 2003, l’année où a été mise en place une nouvelle politique libérale, très différente des politiques antérieures et qui a causé cette très forte montée de la pauvreté. Cette politique repose sur une baisse très importante des dépenses sociales du gouvernement et donc des allocations sociales. Ce qui a entrainé un appauvrissement supplémentaire des plus pauvres, et a fait passer les nécessiteux dans la catégorie des pauvres. La politique libérale a aussi été marquée par une baisse de la pression fiscale. Là encore, cela n’a profité qu’aux riches, puisque les pauvres ne sont pas imposables. Enfin, cette politique a développé les privatisations. Depuis 2003, le gouvernement n’investit plus rien, en particulier dans certains services publics, tels que l’éducation, la santé, les transports en commun. Autant de dépenses qui doivent être payées par les familles, plus qu’elles ne le faisaient avant, pour la santé privée, ou les activités périscolaires. Et quand les services publics sont moins nombreux, ce sont les plus nécessiteux qui doivent payer davantage et s’appauvrir en proportion. Ce sont ces trois volets de la politique libérale, qui a causé cette aggravation de la pauvreté à partir de 2003.
Ces facteurs viennent-ils se greffer sur un terreau particulier ? On voit que les communautés arabes et juives ultra-orthodoxes sont les plus touchées, mais est-ce inhérent à la structure de la société israélienne, ou bien cette pauvreté a-t-elle touché l’ensemble du pays ?
La pauvreté a touché toutes les catégories de la population. Il est vrai que certaines catégories, pour des raisons socioéconomiques l’ont été davantage, notamment les Arabes et les harédim, parce qu’ils participent moins au travail. Il est donc logique qu’ils soient les plus atteints en cas de coupes dans les dépenses sociales, même si depuis, ils ont commencé à s’intégrer plus dans le monde du travail. Mais il y a aussi des pauvres chez les personnes âgées, les familles monoparentales, ou les handicapés. Ce sont bien toutes les couches de la société qui ont été touchées.
La pauvreté ne concerne donc pas seulement ceux qui sont en dehors du monde du travail ?
En effet. Ce qui a changé avec la politique libérale du début des années 2000 a aussi été l’approche du travail et la priorité à l’emploi. Tout le monde doit travailler. Cette priorité à l’emploi aurait dû remplacer les dépenses sociales. Mais on ne s’est pas rendu compte qu’en réalité, on avait créé une nouvelle catégorie, inconnue jusque-là en Israël : celle des travailleurs pauvres. Un pauvre sur deux travaille. Des gens qui touchent un salaire minimum, qui ne suffit pas pour nourrir une famille. On a privatisé le travail. On a aussi supprimé le ministère du Travail, pour le transformer en ministère de l’Emploi, du Commerce et de l’Industrie. C’est-à-dire que l’on a considéré le travail uniquement du point de vue de l’employeur. Les cotisations patronales ont été réduites, les impôts versés par les employeurs ont été diminués, les agences pour l’emploi ont été privatisées. Tout a été fait pour inciter l’Israélien à prendre un travail, mais par le même biais on a créé une nouvelle catégorie de pauvres et le problème de la pauvreté n’a donc pas été résolu.
Quelles sont les tendances qui se dessinent sur l’évolution de la pauvreté en Israël ?
Il faut avoir à l’esprit que la pauvreté a doublé en dix ans. A la fin des années 90, début des années 2000, la pauvreté était à 13%. Elle est passée à 26%, dix ans plus tard. La tendance était donc au doublement de la pauvreté. Puis on a assisté à une forme de ralentissement, parce que le gouvernement a pris quelques mesures à même de freiner l’augmentation de la pauvreté. Cela s’est fait notamment par l’augmentation du salaire minimum, qui a été fortement relevé au cours des trois dernières années. On a également relevé quelques allocations, comme l’allocation vieillesse, qui a été revalorisée de 100 shékels par mois. Donc, la pauvreté, après avoir augmenté très fortement, s’est stabilisée à un niveau extrêmement élevé. Il faut maintenant la diminuer. Or, c’est d’autant plus paradoxal, que depuis quelques années, le contexte est au plein emploi. Cela montre bien que l’emploi ne résout pas la pauvreté. On a des gens qui travaillent, parfois en cumulant plusieurs emplois, sans parvenir pour autant à subvenir à leurs besoins. Les politiques de l’Etat visent pourtant à intégrer davantage de monde sur le marché de l’emploi, notamment les harédim et les Arabes. Depuis bientôt quatre ans, on assiste à une très forte poussée de leur participation sur le marché du travail. Ce qui a effectivement permis de stabiliser la pauvreté, et non plus de la voir augmenter.
Une partie de ces emplois restent d’ailleurs peu qualifiés, voire précaires.
Absolument ! La tendance nouvelle qui est apparue depuis une dizaine d’années avec les travailleurs pauvres, c’est ce que l’on appelle la précarité de l’emploi. C’est-à-dire qu’en Israël, on a des gens qui travaillent sans aucune garantie d’emploi. On a énormément de gens qui travaillent à temps partiel – environ 28% de salariés à temps partiel – et aussi de gens qui travaillent par l’intermédiaire de sociétés de travail par intérim. Il y a également une très forte baisse du taux de syndicalisation. Tout cela concourt à désorganiser le marché du travail. Les emplois ne sont plus fixes. Il n’y a plus de sécurité, ni de certitude du travail. On assiste donc depuis une dizaine d’années à une précarisation du travail. Ces tendances se confirment pour les années à venir.
Comment faire pour ne pas seulement freiner la pauvreté, mais pour parvenir à la réduire et à réduire les inégalités ?
Quand on compare les dépenses sociales d’Israël avec celles de la moyenne des pays de l’OCDE, on s’aperçoit qu’Israël est dans les derniers rangs. La première réponse est donc qu’Israël doit dépenser davantage sur le plan social. Tout ce qui concerne la protection sociale a été pratiquement gelé au début des années 2000. Il faut mettre davantage d’argent dans certaines allocations, dans les services publics, pour que les Israéliens n’aient plus à payer pour la médecine privée ou pour l’éducation privée. Il faut davantage de services publics, et cela aussi coûte de l’argent. Il faut que l’Etat investisse lui-même dans certains équipements publics. Les transports en commun doivent être pris en charge par l’Etat et non par des fournisseurs privés. C’est l’Etat qui doit construire les hôpitaux et non des investisseurs privés. L’Etat doit donc s’investir davantage dans l’économie. Mais encore une fois, c’est contraire à la logique libérale, qui prône le désengagement de l’Etat. Et tant que cette logique prévaudra, il n’y aura aucune solution en vue.
Il n’y a donc aucun argument objectif qui puisse convaincre une stratégie libérale d’arrêter d’être libérale ?
Absolument aucun. Même les recommandations que l’OCDE adresse deux fois par an à Israël pour l’augmentation de ses dépenses sociales, n’ont aucune raison d’être suivies d’effet.
On assiste aussi à un phénomène où c’est la société civile, par l’action d’associations, qui vient suppléer en quelque sorte à la carence des pouvoirs publics. Est-ce que cela peut contribuer à réduire ces disparités sociales, ou est-ce un emplâtre sur une jambe de bois ?
Il est vrai que c’est un phénomène relativement nouveau en Israël. Le secteur humanitaire, les ONG ont pris la relève de l’Etat. Là où l’Etat s’est retiré, où il n’a pas dépensé suffisamment d’argent, ce sont des organisations qui ont pris sa place. C’est très bien qu’il y ait des associations qui s’occupent de social de façon générale. Mais ce n’est pas bien que ces associations prennent la place qui incombe à l’Etat. Ce n’est pas bien que l’Etat, comme cela se fait aujourd’hui, finance des associations pour qu’elles distribuent des repas ! C’est quelque chose que l’on n’aurait pas dû voir. Au lieu de travailler avec l’Etat, à côté de lui, comme c’est le cas dans d’autres pays occidentaux, ici les associations ont dû prendre la place de l’Etat, là où il était défaillant, et cela, c’est très grave. C’est une conséquence directe de ce type de politique libérale.
Pourtant, la pauvreté n’est pas un problème abstrait. Les Israéliens s’en préoccupent. Pourquoi cela ne se reflète-t-il pas plus dans le débat public ? Est-ce dû à l’absence de différences idéologiques fondamentales dans les partis qui composent aujourd’hui le paysage politique israélien ?
Non. C’est parce que lorsqu’on arrive dans l’isoloir, on va mettre un bulletin de vote qui sera déterminé par les questions sécuritaires et non par les questions sociales. En Israël, on le sait aussi, plus qu’ailleurs, les pauvres votent à droite et les riches à gauche. Il y a donc peu de chances de voir un changement de tendance dans les années à venir. La réponse se fait par les urnes.
Est-ce que le morcellement de la société israélienne en différents secteurs de population – orthodoxe, arabe, olim, religieux, etc. – a un poids sur le phénomène de la pauvreté ?
Oui, parce qu’Israël est une société très structurée par des types de communautés et de populations, ayant chacun leur mode de vote, leurs problèmes culturels. Mais là encore, la politique libérale ne fait qu’aggraver, exacerber cette fragmentation de la société, au lieu de la ressouder.