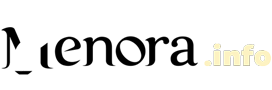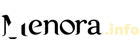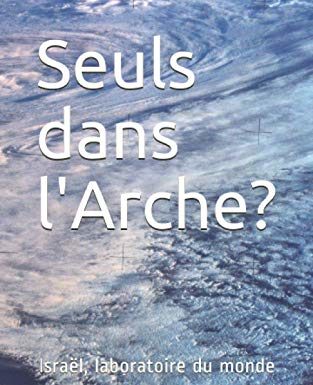Chef du département de sociologie de l’Université Bar Ilan, le Professeur Larissa Remennick a publié de nombreuses études sur l’alyah des Juifs de l’ancien bloc soviétique, notamment sur la génération intermédiaire qui a dû se construire entre deux cultures.
Propos recueillis par Pascale Zonszain
Menora.info : Qui sont les olim russes de la « génération un et demi » ?
Larissa Remennick : On parle d’environ 160.000 à 170.000 personnes. Ce sont aujourd’hui de jeunes adultes, âgés de 25 à 40 ans, qui sont arrivés en Israël avec la grande vague d’alyah de l’ex-URSS, alors qu’ils étaient enfants ou adolescents, en âge scolaire. C’est-à-dire que la plupart d’entre eux avaient déjà été scolarisés dans leur pays d’origine, avaient appris à lire et à écrire dans leur langue maternelle. Ce sont les parents qui ont décidé de leur émigration vers un nouveau pays, alors qu’eux-mêmes n’ont pas été partie prenante dans cette décision. Car la plupart de ces jeunes – 80% environ – sont arrivés avec leur famille, tandis qu’une minorité est arrivée seule dans le cadre de programmes de l’Agence Juive, du type « Naaléh ». On sait qu’il est très difficile d’émigrer à l’adolescence, surtout pour des adolescents qui ne l’ont pas décidé. Ils ont dû quitter tout ce qui faisait leur vie, leurs amis, leurs écoles, et tout recommencer à zéro. Du fait que leur enfance a débuté dans leur pays d’origine, leur identité s’est dédoublée. D’un côté, l’influence de l’identité russe, ukrainienne, soviétique et l’influence des parents, du foyer où ils ont grandi, sont restées très fortes. De l’autre, ils ont poursuivi leur éducation en Israël, ont ensuite servi dans l’armée, puis ont fait leurs études à l’université. Tout cela leur confère une identité très ambivalente et double. C’est pour cela qu’on les appelle la « génération un et demi ». Ils n’appartiennent pas à la première génération, comme leurs parents qui sont arrivés à l’âge adulte avec une identité déjà formée et ont dû s’adapter à une nouvelle société. Ils n’appartiennent pas non plus à la deuxième génération, née en Israël de parents immigrants. Ils sont entre les deux.
Qu’est-ce qui distingue cette « génération un et demi » ?
C’est son identité double qui en fait un phénomène très intéressant à étudier d’un point de vue social. Il y a toutes sortes d’aspects sur la façon dont ces jeunes se voient, par rapport à leur identité, à leur culture, aux langues dans lesquelles ils s’expriment, au choix de leur conjoint, pour ceux qui sont déjà mariés et chefs de famille. Nous avons effectué toute une série d’études sur ces jeunes adultes d’origine russe, qui forment une part très importante de la société israélienne. Qui sont-ils, d’où sont-ils, se sont-ils totalement intégrés dans la société de leurs contemporains israéliens, ou se considèrent-ils encore comme un groupe à part ? Ça n’est d’ailleurs pas propre à l’alyah de Russie. Cette génération « un et demi » existe aussi dans les autres groupes d’alyah, comme celle de France par exemple. Le fait que pour la grande majorité d’entre eux, ces jeunes n’aient pas eux-mêmes décidé de leur émigration, rend leur période de transition beaucoup plus difficile.
Quelles sont les difficultés auxquelles ces jeunes sont confrontés ?
Cela commence par leur arrivée dans une nouvelle école. Il leur est très difficile de s’intégrer parmi les Israéliens de leur âge, qui, on l’a vu, ne les accueillent pas toujours à bras ouverts.
Est-ce le début de leur intégration qui a été difficile, ou est-elle devenue plus difficile avec le temps ?
C’est toujours difficile au début. Les cinq à sept premières années de l’immigration sont les plus dures. Il s’agit de s’intégrer dans des établissements scolaires très différents, car le système éducatif israélien n’a rien à voir. Il faut aussi assimiler une langue différente. Contrairement à l’alyah de France, dont certains jeunes ont été scolarisés dans des écoles juives, les olim de l’ex-URSS sont arrivés sans connaitre un seul mot d’hébreu. Il leur a fallu arriver dans des classes où ils ne comprenaient rien et où ils n’ont reçu que très peu d’aide. On les a jetés à l’eau et ils ont dû apprendre à nager tous seuls. Ils sont de plus issus d’une culture totalement laïque et il leur a été difficile de s’adapter aux études bibliques et à toutes les disciplines d’études juives, qu’ils n’avaient jamais connues jusque-là.
Les difficultés ont-elles été seulement d’ordre scolaire ?
Non. L’adolescence est aussi le moment où se forme l’identité sexuelle, où les relations avec les parents changent. C’est l’âge de la rébellion. Cela suffit déjà à une identité confuse. Alors quand cela se double de la crise liée à l’émigration, c’est encore plus dur. Certains n’ont pas tenu et ont décroché du système scolaire. Et ceux-là n’ont évidemment pas pu faire d’études supérieures. Cela a été difficile tant pour eux-mêmes que pour leurs parents. Chez les Juifs russophones, les diplômes universitaires sont une tradition très forte. La majorité des adultes arrivés en Israël sont diplômés de l’enseignement supérieur. Or, les enfants n’ont pas tous réussi à cause du premier barrage d’intégration au début de leur scolarisation en Israël.
Et aujourd’hui ?
On est maintenant vingt ou vingt-cinq ans plus tard. Les choses ont changé. La grande majorité de ces jeunes parle l’hébreu, a servi dans les rangs de Tsahal, étudié et acquis une profession. Ils sont devenus tout à fait israéliens. Mais les études que nous avons réalisées montrent que ces jeunes ont une conception très différente de leur identité, sur « qui je suis ? », « qu’est-ce que je suis ? ». Ils ne se sentent pas israéliens jusqu’au bout. Même après vingt-cinq ans.
Y a-t-il une différence dans cette génération entre les olim juifs et ceux qui n’ont pas été reconnus comme tels ?
C’est une distinction importante, qui est pour beaucoup au cœur du problème. Nombre de ces jeunes sont issus de familles mixtes, dont le père est juif, mais pas la mère. On estime entre un tiers et 40% le nombre de ces jeunes Israéliens qui ne sont pas reconnus comme Juifs selon la Halacha. Cela leur pose d’abord des problèmes pour se marier en Israël. Et cela les révolte. Alors qu’ils sont des citoyens, qui remplissent tous leurs devoirs envers l’Etat, qui travaillent, servent dans l’armée et payent leurs impôts comme tous les autres citoyens juifs, l’Etat ne leur reconnait pas le droit élémentaire accordé à tous les autres, de se marier dans ce pays. Ils sont obligés de se marier civilement à l’étranger, pour faire ensuite enregistrer leur union par l’état-civil israélien. C’est un des sujets les plus douloureux pour eux et ils en ont fait un combat politique, afin d’influer sur le débat des rapports entre la religion et l’Etat. Ils veulent une réforme de la définition de qui est juif, qui pourrait comprendre la reconnaissance de la judéité du père et non plus seulement de la mère, comme le font déjà un certain nombre de courants du judaïsme réformé. Mais dans la configuration politique actuelle, les chances de succès d’une telle réforme sont extrêmement faibles. Le rabbinat orthodoxe et les partis religieux ont toujours une très forte influence. Mais cela ne les empêche pas d’essayer et de maintenir le sujet à l’ordre du jour du débat public et politique. Là où la génération des parents a gardé le silence et accepté la règle sans protester, celle de leurs enfants estime qu’elle a droit à l’égalité et elle la revendique. C’est un phénomène que l’on retrouve dans d’autres groupes d’immigration, où la jeune génération n’est pas disposée à subir les humiliations ou les discriminations endurées par leurs ainés.
Ces jeunes Israéliens sont-ils attirés par un retour à leur culture d’origine ?
Il y a beaucoup d’intérêt pour la culture russe. On voit beaucoup de groupes se former sur internet, ou dans le cadre de clubs, pour renforcer les liens avec la culture russe et soviétique, à travers le théâtre, la poésie ou la littérature. Nous sommes issus d’une culture très riche et très variée, construite sur la période classique et celle de 70 ans de socialisme. Même durant ces années, la création artistique est restée vivace, dans la littérature, le cinéma, les arts plastiques ou la musique. Nous sommes riches d’un patrimoine culturel auquel nous ne sommes pas prêts à renoncer. Et il n’y a pas de raison d’y renoncer. Aujourd’hui, les jeunes de la « génération un et demi » initient toutes sortes de projets qui sont autant de passerelles entre ce patrimoine et les jeunes qui ne connaissent pas du tout cette culture russe. Les femmes sont particulièrement actives, notamment dans le domaine de la poésie. Je pense par exemple à Rita Kogan qui a publié des recueils de poésie qui ont été récompensés par des prix. La thématique est souvent liée au traumatisme de l’émigration, au statut de la femme russe dans la société israélienne, qui souffre d’une image très négative, qui ne s’est pas effacée avec les années. « Les filles russes sont des p…. », c’est un stéréotype qu’on entend encore en Israël. Dans la tête du mâle israélien moyen, les femmes russes sont « permises ». C’est une des raisons pour lesquelles on trouve tant de femmes engagées aujourd’hui dans cette renaissance de la culture russe, mais aussi dans l’activisme public en Israël contre le harcèlement sexuel. On voit d’ailleurs beaucoup de groupes de parole se former sur les réseaux sociaux chez ces jeunes qui partagent leur expérience. Et elles le font en hébreu.
L’hébreu est donc devenu la langue d’expression de la « génération un et demi » ?
C’est effectivement le cas pour une large part de l’activité culturelle et sociale. Il y a par exemple cette plateforme internet qui s’appelle « génération un et demi » et qui propose toutes sortes de thèmes. Sans parler des festivals et d’autres événements culturels, qui couvrent tous les genres de l’expression artistique contemporaine. Et toujours dans un hébreu très maitrisé. Et il y a aussi l’influence orientale, qui donne des mélanges intéressants avec le style russe, produisant un genre hybride inédit.
Peut-on parler d’un nouveau groupe identitaire israélien ?
Absolument ! Il y a une activité extrêmement riche tant dans le domaine culturel que dans celui de l’activisme public et aussi sur les réseaux sociaux. Tout cela combiné forme un groupe identitaire séparé du reste des jeunes « Sabras ». Ces jeunes de la « génération un et demi » se marient aussi souvent entre eux, environ 50%. Et dans leur environnement social, ils se sentent plus à l’aise avec des jeunes de la même origine qu’eux, qui ont vécu la même expérience qu’eux. Ce phénomène n’est d’ailleurs pas propre à l’immigration russe et mériterait des études comparées avec d’autres groupes, comme celui de l’alyah de France.
Sait-on quelle est la proportion de ces jeunes qui quittent Israël ?
Il n’existe pas de statistiques précises. Mais selon les différentes études que nous avons effectuées, ces jeunes de la « génération un et demi » sont nombreux à y penser. Ils ne sont pas assis sur leurs valises, mais ils cherchent des possibilités de vie à l’étranger. Car beaucoup ont l’impression d’avoir atteint le plafond de verre dans leur profession, dans leur développement personnel. Ils sont environ 40 à 50% à avoir une formation universitaire et travaillent souvent dans des secteurs tels que la haute technologie, la santé ou la biotechnologie, qui leur permettraient de trouver à l’étranger des opportunités professionnelles beaucoup plus lucratives et avec un profil de carrière beaucoup plus intéressant qu’en Israël, qui reste un petit marché. Et surtout, certains d’entre eux estiment qu’ils ne sont pas encore traités sur un pied d’égalité et qu’on leur préfère des Sabras, nés dans le pays. 30 à 40% d’entre eux sont ouverts à l’idée que si une occasion se présente à l’étranger, ils envisageront sérieusement de la saisir, sinon définitivement, du moins pour quelques années. Cela peut être vers l’Europe ou les Etats-Unis, là où on leur offrira des options plus intéressantes, professionnelles ou universitaires. On sait qu’environ 10% des olim de Russie ont quitté Israël et la majorité d’entre eux appartenaient à la catégorie « non-juifs ». Ce sont ceux qui se sont sentis le moins chez eux. Il était donc logique qu’ils constituent l’essentiel de cette émigration.
Cette option de l’émigration, même non réalisée, est-elle préoccupante ?
Bien sûr. Cela fait des années que nous pointons ce problème. Nous nous battons sans arrêt pour promouvoir l’alyah, nous cherchons à travers le monde tous les Juifs, « demi-Juifs » ou « quart de Juifs », nous les faisons immigrer en Israël, pour les laisser ensuite se débrouiller par eux-mêmes. Ces olim ne reçoivent pas assez d’assistance, ils ont parfois des difficultés d’intégration et certains repartent. C’est dommage, surtout quand on pense aux efforts déployés pour les faire venir. Ces Israéliens ont gardé leur passeport russe ou ukrainien, surtout ceux qui ont immigré récemment. Ils peuvent retourner dans leur pays d’origine, ou pousser jusqu’à Berlin ou New York. Les Israéliens de la « génération un et demi » ont grandi avec une vision très mondialiste. Ils ont grandi dans une société ouverte. Ils ne se sentent pas une fidélité absolue dédiée uniquement à la société israélienne. Surtout quand ils ont l’impression que cette société n’apprécie pas à sa juste valeur tout ce qu’ils lui ont donné.