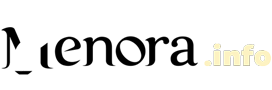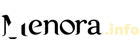Dans un contexte où l’on refuse de considérer comme antisémites la torture et le meurtre de Sarah Halimi commis au rythme de l’incantation « Allah Ouakbar » et où de nombreux intellectuels sont régulièrement sommés par les médias de s’expliquer sur leur propos concernant l’islam, il est symptomatique que l’historien Georges Bensoussan ait pu être poursuivi pour « provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence » parce qu’il a décrit une partie des musulmans de France comme antisémites. Le climat raciste et antisémite bouillonnant qui s’est imposé en France est l’objet d’un déni profond.[1] Pire, qu’un historien comme Georges Bensoussan s’aventure à dénoncer l’antisémitisme ambiant et c’est lui qui se retrouve devant un tribunal. Les mots sont sous surveillance et la justice est fréquemment sollicitée pour décider de ce qu’il est licite de dire.
Comme nous le verrons, cela pose de nombreuses questions linguistiques : peut-on parler négativement d’un groupe humain sans que la généralisation qui en découle ne soit nécessairement considérée comme incitation à la haine ? Le pluriel entraîne-t-il une catégorisation nécessairement illégitime ? Les métaphores corporelles doivent-elles se comprendre dans le cadre d’une interprétation raciale ?
Dans l’émission de radio Répliques (10/10/2015), Georges Bensoussan constatait l’« antisémitisme viscéral […] d’un autre peuple qui se constitue au sein de la nation française qui fait régresser un certain nombre de valeurs démocratiques qui nous ont portés… ». Il reprend plus loin les propos du sociologue Smaïn Laacher en y ajoutant une dimension métaphorique : « C’est une honte de maintenir ce tabou, à savoir que dans les familles arabes en France, et tout le monde le sait mais personne ne veut le dire, l’antisémitisme, on le tète avec le lait de la mère ».
J’ai déjà souvent décrit le mécanisme rhétorique d’accusation qui se met en place contre Israël, contre les Juifs et contre l’Occident. Il repose sur la manipulation de la notion de victime dont l’actantialité suppose un agresseur et un agressé, les torts reposant sur l’agresseur. Face aux agressions musulmanes (qu’il s’agisse d’attentats, de meurtres, de viols, d’incivilités), l’argumentation qui revient systématiquement, de manière diffuse et selon des modalités propres à chaque événement, est constituée de plusieurs phases qui prennent des formes variables :
- déni de l’acte
- atténuation de l’acte
- excuse
- retournement
- accusation et pointage de la victime.
Le cas de Georges Bensoussan n’échappe pas à cette règle. Lanceur d’alerte contre l’antisémitisme musulman et le risque de sécession culturelle d’une partie importante de la population musulmane en France, il s’est retrouvé accusé d’inciter à la haine. Cette absurdité logique — celui qui dénonce la haine est accusé par cette dénonciation même d’y inciter — repose sur divers postulats juridiques, politiques et idéologiques dont la confusion est mise en mots par divers acteurs militants dont les objectifs d’intimidation sont patents. Cette instrumentalisation de la rhétorique des droits de l’homme et du droit français sert à empêcher toute critique de l’islam. Imposer un concept creux comme l’« islamophobie » par la jurisprudence revient à fétichiser l’islam comme tabou, comme signe intouchable, c’est-à-dire à obtenir que la critique de l’islam possède une charge blasphématoire — inquiétante confusion entre la sharia et le droit français…
Cela prend place dans un contexte politique favorable à l’entrisme islamique dont les représentants les plus radicaux, comme les Frères Musulmans, sont devenus des partenaires au plus haut niveau de l’état. Il faut aussi prendre en compte la pression exercée par certaines populations de banlieue, pour une large part musulmanes, promptes à déclencher des manifestations ou des émeutes. Or, comme on le verra, le jugement rendu évite de se prononcer sur la réalité des faits décrits par Georges Bensoussan. On peut apprécier la logique juridique, mais cela pose des problèmes de fond qui concernent le rapport à la réalité politique et non une conception technique du droit préférant louvoyer pour ne pas se prononcer sur le réel. Les travaux attestant de la matérialité de l’antisémitisme musulman et de son enracinement culturel sont pourtant nombreux.[2] La question de fond est donc celle-ci : comment peut-on construire une accusation contre la dénonciation de l’antisémitisme musulman alors que le fait antisémite musulman est avéré ?
Une accusation idéologique : la métaphore et le racisme
Georges Bensoussan était accusé par le Collectif Contre l’Islamophobie en France, la Ligue International contre le Racisme et l’Antisémitisme, la Ligue Française pour la Défense des Droits de l’Homme et du Citoyen, SOS Racisme et le Mouvement contre le Racisme et pour L’Amitié entre les Peuples du délit de « provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » (loi no 72-546 du 1er juillet 1972). On appréciera l’ironie voulant que des associations censées lutter contre l’antisémitisme s’en prennent à quelqu’un qui le signale.
Voici le point de départ de l’accusation :
« Lors de l’audience, les associations souhaitant se constituer parties civiles sollicitaient la condamnation de Georges Bensoussan, les propos poursuivis assimilant selon elles les musulmans à un corps étranger à la nation et tendant à leur essentialisation, l’ensemble des musulmans étant accusés d’être élevés dans l’antisémitisme, voire d’être génétiquement antisémites et le prévenu ne pouvant, par son parcours et sa formation d’historien, prétendre ignorer la portée de ses accusations et leur caractère à la fois blessant, discriminant et provocateur. »[3]
On remarque que la question de la vérité et de la pertinence des propos de Georges Bensoussan n’est pas posée. On leur reproche « leur caractère à la fois blessant, discriminant et provocateur », ce qui ne préjuge en rien de la validité du constat établi par l’historien. Cette incantation accusatoire n’a d’ailleurs pas un caractère juridique très affirmé : se sentir blessé ne constitue pas une caractérisation légale mais un sentiment psychologique qui impose un paradigme victimaire. De même pour l’adjectif « discriminant » qui joue sur les connotations politiques de la notion d’isolement, d’apartheid, de ghettoïsation, confondant la discrimination dans son sens juridique et moral (l’idée d’un traitement inégalitaire) et dans son sens intellectuel (au sens de « différencier », « distinguer »). Or, les propos de Georges Bensoussan dénoncent justement la division communautariste et la différence de traitement d’un groupe envers un autre. Quant à l’adjectif « provocateur », comme les deux autres, il fait de Georges Bensoussan le fauteur de trouble et joue sur la connotation juridique qu’il suggère (« provocation à la haine ») — sauf que « provocateur » et « provocation » n’ont pas le même statut grammatical et pas le même statut juridique : « provocateur » constitue une appréciation subjective, « provocation » décrit un acte avéré.
Dans les trois cas, « blessant, discriminant et provocateur » sont des adjectifs agentifs : ils construisent une opposition entre un agent et un patient, installant les musulmans comme patients, c’est-à-dire victimes et Georges Bensoussan comme agent, c’est-à-dire comme oppresseur. Ces trois adjectifs construisent une conglobation, c’est-à-dire une accumulation qui donne de la force à l’accusation alors même que chacun d’entre eux est éminemment discutable. C’est un procédé stylistique récurrent dans l’argumentation anti-israélienne[4] et dans les attaques de mauvaise foi : s’il trahit une grande faiblesse intellectuelle et descriptive, il possède une grande efficacité rhétorique parce qu’il suggère une ampleur indicible des torts sans se donner la peine d’en démontrer la réalité.
On remarque aussi que les parties civiles se scandalisent et s’estiment blessées non pas d’être éventuellement antisémites mais qu’on puisse les envisager comme « un corps étranger à la nation » et les « essentialiser ». Or, ce reproche formulé par Georges Bensoussan n’est pas une projection de sa part mais le constat qu’une « partie » des musulmans, de fait, revendique sa différence identitaire comme étrangère à la nation. Logiquement, la stratégie argumentative des parties civiles consiste à se présenter comme victimes car cela repose sur le cadre juridique qui a été choisi pour accuser Georges Bensoussan, « l’incitation à la haine », et non pas la diffamation qui impliquerait de mettre au cœur des débats la réalité des faits.
Les témoins cités par les parties civiles ont aligné des argumentations douteuses qui renforcent en fait l’impression d’une tentative d’intimidation sans fondements intellectuels. C’est flagrant dans les interventions résumées par le jugement :
« Nacira Guenif, sociologue, professeur des universités, citée comme témoin par le CCIF et l’association SOS Soutien Ô Sans Papiers, soulignait à quel point, selon elle, la métaphore employée par Georges Bensoussan était porteuse de racisme, le lait renvoyant au sang et, partant, à la race. Elle précisait que ses travaux ainsi que ceux d’autres sociologues démontraient que l’antisémitisme prêté aux musulmans, notamment aux jeunes vivant dans les banlieues, était bien plus de l’ordre d’un ressentiment d’ordre général, alimenté par le sentiment d’abandon après les révoltes de 2005, le colonialisme ou l’impression que toute critique d’Israël était assimilée à un propos antisémite, que du rejet des juifs, de même que, toujours selon elle, le fait, dans le monde arabe, d’utiliser le terme « juif, je m’excuse » comme un insulte devait être analysé comme un recours quasi-mécanique à une expression usuelle qui avait perdu son sens initial » (p. 3).
Le témoignage de Nacira Guenif montre de grandes confusions intellectuelles au point où l’on peut se demander si ces confusions ne sont pas volontaires. Parler des musulmans, c’est parler d’une religion et d’une culture. Dès lors, pourquoi parler de racisme, l’islam n’étant pas une race — et Georges Bensoussan n’ayant absolument pas dit que l’islam constitue une race ? Cette tactique sans socle logique consiste en réalité à faire à tout prix survenir le mot « racisme » pour pouvoir délégitimer son adversaire. En quoi le lait renvoie-t-il au sang ? Que signifie concrètement le mot « renvoyer » ? Pourquoi mettre en réseau « lait-sang-race » ? Par quelle subtilité tordue prêterait-on au mot « lait » les connotations du mot « sang » auquel on donnerait soudain une valeur strictement raciale ? Et en quoi cela impliquerait-il une aberration selon laquelle le racisme pourrait se transmettre génétiquement ? Et surtout, pourquoi attribuer à Georges Bensoussan, en somme, d’avoir dit que le racisme serait génétique sinon par mauvaise foi intellectuelle ? Et même si tous ces raisonnements tordus étaient avérés, en quoi serait-il interdit de penser de telles bêtises ? Une telle incohérence dans des raisonnements accusatoires tirés par les cheveux permet surtout de constater qu’on veut faire semblant de ne pas comprendre ce que Georges Bensoussan veut dire et l’associer à l’idée de racisme. Cela repose sur l’habituation lexicale bien connue consistant à mettre sans cesse en rapport la mention de l’adversaire avec des mots dont l’incantation permet d’instaurer une représentation négative.[5]
Rappelons les usages de la langue française. Le Trésor de la Langue Française signale l’emploi figuré du mot « lait » au sens de « première nourriture spirituelle » et les locutions verbales « boire / sucer avec le lait une philosophie, une doctrine, une opinion, etc. » au sens de « la recevoir dès la plus tendre enfance ». Ce dictionnaire cite d’ailleurs Balzac, Zola et Lamartine pour l’illustrer :
« Vous avez sucé dans vos lycées le lait de la révolution, et vos idées politiques peuvent s’en ressentir » (Balzac, Lys, 1836, p. 103).
« Son fils aîné, ainsi que son second fils, l’abbé de Lamartine, élevés l’un et l’autre dans les doctrines du dix-huitième siècle, avaient sucé, dès leur enfance, le lait de cette philosophie qui promettait au monde un ordre nouveau » (Lamart., Confid., 1849, p. 35):
« En lui, l’homme civilisé se révoltait, la force acquise de l’éducation, le lent et indestructible échafaudage des idées transmises. On ne devait pas tuer, il avait sucé cela avec le lait des générations… » Zola, Bête hum., 1890, p. 205.
La sociologue accusatrice ne raisonne pas, elle exploite la contiguïté des signifiants sans la moindre rigueur démonstrative. Cela met sous surveillance les métaphores qui engagent le corps : on peut imaginer que l’utilisation d’expression comme « avoir quelque chose dans la peau / dans le sang », hyperboles lexicalisées indiquant une profonde imprégnation, devienne passible des tribunaux. En procédant de manière allusive, l’accusation exploite le pouvoir évocatif des mots et non leur signification effective. Les emplois métaphoriques de mots ayant trait au corps (« lait », « sang », « peau »…) sont manipulés par une inquisition lexicale comme des instruments censés prouver l’existence du racisme. Ces vigilants penseurs de l’orthodoxie, militants exclusifs de la défense de l’islam, pointent les signifiants au détriment de la pensée. Comme des tabous blasphématoires, certains mots deviennent ainsi automatiquement suspects, par le biais pervers de prétextes iréniques qui font semblant de rechercher la concorde tout en boutant le feu de la division identitaire.
On note aussi dans son argumentaire une profonde mauvaise foi qui prend le prétexte des sciences humaines pour construire un arsenal conglobatoire d’excuses puisque ses travaux auraient montré que
« l’antisémitisme prêté aux musulmans, notamment aux jeunes vivant dans les banlieues, était bien plus de l’ordre d’un ressentiment d’ordre général, alimenté par le sentiment d’abandon après les révoltes de 2005, le colonialisme ou l’impression que toute critique d’Israël était assimilée à un propos antisémite, que du rejet des juifs »
Elle parvient là à démontrer l’inverse de ce qu’elle veut dire : les jeunes des banlieues, pour exprimer un ressentiment « d’ordre général », s’en prennent aux Juifs. C’est bien là la définition de l’antisémitisme… Le « ressentiment » est une excuse de circonstance et non une explication causale positive — ou alors il faudra remarquer que le ressentiment des Juifs, après la seconde guerre mondiale, ne s’est exprimé ni par une violence anti-française ni anti-musulmane. On remarque aussi la manière subtile dont le témoin minimise l’existence de l’antisémitisme musulman (« l’antisémitisme prêté aux musulmans » suggère qu’il n’est pas réel)… avant d’en donner des causes — qui servent d’excuse.
Autre torsion logique préoccupante, sa façon de retourner la causalité quand elle dit que cet antisémitisme serait dû à « l’impression que toute critique d’Israël était assimilée à un propos antisémite » : c’est donc l’accusation d’antisémitisme qui créé l’antisémitisme. Quant à la chronologie proposée, « le sentiment d’abandon après les révoltes de 2005 » (outre la victimisation inhérente au terme « révolte » qui légitime ce qu’on pourrait aussi décrire comme des « violences », des « émeutes », etc.), elle établit une borne récente à l’antisémitisme musulman, niant des siècles de persécution ancrés dans des textes sacrés.[6] Cette mauvaise foi systématique, faite de déni, de détournements et de demi-vérités, sert à cacher la réalité historique et trahit une entreprise idéologique de travestissement de la réalité.
Un autre témoin, Michèle Sibony, enseignante évoque
« Les territoires perdus de la République, portant un regard malveillant sur les élèves vivant dans les quartiers ainsi stigmatisés et contribuant à accroitre des tensions qui pouvaient exister, mais qui n’avaient ni l’importante ni la nature qui leur était attribuées » (p. 4)
Ce qui est suggéré par l’emploi causal de « ainsi stigmatisés », de « contribuant à accroitre les tensions » et l’utilisation de l’imparfait qui dessine un « avant » et un « après » publication, c’est que l’ouvrage de Georges Bensoussan est responsable de l’antisémitisme et des comportements peu citoyens d’une partie des « quartiers ». Notons qu’il ne s’agit pas d’une imputation directe mais plutôt d’une insinuation. On peut imaginer causalité plus évidente pour expliquer le phénomène de l’antisémitisme ou des troubles sociaux, sauf si l’on considère que c’est la lecture de l’ouvrage en question qui a déclenché le ressentiment antisémite dont on trouve pourtant la trace fréquente depuis l’an 622…
Autre insinuation non assumée, l’emploi du terme « tension » qui décrit une forme de réciprocité parfaitement fausse : on n’a pas trouvé de bandes de Juifs qui s’en prennent aux musulmans, ni de milices anti-musulmanes imposant leur loi par la violence dans les quartiers. Sur le plan sémantique, le mot « tensions » sert à gommer l’actantialité de la violence et permet de masquer son caractère en réalité unilatéral.
De son côté, le journaliste Mohamed Sifaoui déplore que
« la généralisation de type quasi-biologique que [Georges Bensoussan] avait opérée, méconnaisse la réalité, à savoir que si une partie des musulmans pouvait, de fait, être considérée comme antisémite ou avoir été élevée dans l’antisémitisme, nombre d’entre eux en revanche luttaient précisément contre l’antisémitisme, lui-même par exemple, ayant ainsi à cœur de dénoncer le manque d’empathie de la communauté arabo-musulmane vis-à-vis de la Shoah. » (p. 4)
A la manière d’une dénégation où se révèle ce que l’on refoule, là encore, la réalité refait surface au sein même de son maquillage : Mohamed Sifaoui nie l’antisémitisme de la population musulmane… tout en signalant qu’il le combat. L’opposition entre « une partie des musulmans » et « nombre d’entre eux » est saisissante : d’une part, atténuation de la réalité de l’antisémitisme musulman et, d’autre part, exagération de l’action militante contre l’antisémitisme — on peinera à trouver en banlieue une véritable mobilisation musulmane pour l’enseignement de la Shoah…
Le plus surprenant, comme le signale avec justesse le jugement, est que Mohamed Sifaoui lui-même a écrit : « j’ai honte de ces sociétés abreuvées par la culture de l’indifférence quand elles ne sont pas nourries à la mamelle de la haine antisémite. » [7] Le sociologue Smaïn Laacher a également évoqué le contexte de « toutes les familles arabes » pour constater que l’antisémitisme était « déposé sur la langue […] comme dans l’air qu’on respire » — sans s’embarrasser de nuances quantitatives, ni parler de « musulmans » plutôt que d’« Arabes ». Comment se fait-il que Smaïn Laacher et Mohamed Sifaoui n’ait pas été les cibles de poursuites ? Ce « deux-poids, deux mesures » est un argument en la défaveur de l’accusation puisque cela démontre sa mauvaise foi, étant donné qu’elle accepte des uns ce qu’elle refuse à Georges Bensoussan.
Le ministère public reproche « la radicalité et la généralisation » des propos de Georges Bensoussan car
« Il s’en était pris à l’ensemble des musulmans, désignant ceux-ci comme un sous-groupe incompatible avec les valeurs de la République et tout entier animé par l’antisémitisme ». Il considère que ces déclarations « appelaient au passage à l’acte » (p. 4)
La procureure a ainsi reproché à Georges Bensoussan d’avoir lui-même commis un « passage à l’acte dans le champ lexical ».
L’argumentation de la procureure est pour le moins étrange. D’une part, l’état de la réalité que Georges Bensoussan dénonce est imputé à Georges Bensoussan lui-même. D’autre part, on lui reproche, la « généralisation » de ses propos — en somme d’avoir mis tous les musulmans « dans le même panier ». C’est précisément en cela que l’analyse de Georges Bensoussan est alarmante : il évoque une dimension culturelle profonde de l’antisémitisme. Pourquoi serait-il délictueux de le constater ? Quand bien même Georges Bensoussan aurait-il tort, son erreur d’analyse devrait-elle considérée comme un délit ?
De plus, caractériser les paroles de Georges Bensoussan comme « un appel à un passage à l’acte », trahit un rapport à la réalité politique assez lâche. Quand dans l’histoire y a-t-il eu des lynchages d’antisémites — qui plus est d’antisémites qui ne le seraient en fait pas ? Le risque de « passage à l’acte » n’est pas un risque, c’est une réalité et elle pèse uniquement sur les Juifs. La réalité des vingt dernières années est justement celle d’agressions envers les Juifs, ce qui a causé leur départ des zones où les musulmans sont démographiquement majoritaires. Les meurtres de Ilan Halimi, de l’école Ozar haTorah, de l’Hyper Casher et la longue litanie des agressions, violences recensées par l’Observatoire du Monde Juif ou par le Bureau National de Vigilance Contre l’Antisémitisme[8] sont sans aucun équivalent envers les musulmans.
Quant à parler d’un « sous-groupe incompatible avec les valeurs de la République », c’est bien ainsi que se définit une nébuleuse islamo-gauchisme, spontanée et parfois bien structurée, à la manière des Indigènes de la République dont la porte-parole « prône l’absence de métissage avec les Blancs et, à minima, en cas de mariage interethnique, la conversion du Blanc à l’islam ». [9] On ne compte plus les manifestations à caractère antisémite sous couvert d’antisionisme ou de « pro-palestinisme » où l’on crie « Mort aux Juifs ». Ces événements récurrents s’inscrivent justement dans une logique de sécession, de rejet de la France et de haine anti-juive.[10] Ce climat n’autorise-t-il pas à constater, de fait, que se constitue un large mouvement de nature identitaire fondé sur l’appartenance ethno-religieuse arabo-musulmane ?
Enfin, le vocabulaire de la procureure montre un indice stylistique de mauvaise foi quand elle accuse Georges Bensoussan d’avoir commis un « passage à l’acte dans le champ lexical ». En psychiatrie, le passage à l’acte est précisément constitué par le fait qu’il s’agit d’une conduite impulsive qui ne parvient pas à s’exprimer par la parole. L’oxymoron malheureux de la procureure n’est pas un plaisant paradoxe mais une simple contradiction qui montre que l’exagération a pour seul ambition de gonfler la charge contre l’accusé et aucunement de définir la nature de ses paroles. De plus, elle aurait pu se contenter de dire « verbal » ou « langagier », mais « lexical » donne l’impression d’un vocabulaire technique, d’une sorte de validation par la science linguistique. C’est du reste la raison de l’emploi de « passage à l’acte », qui fait partie du vocabulaire de la psychopathologie et suggère une forme de violence incontrôlable. L’insinuation par le biais du vocabulaire caractérise un défaut d’argumentatif : le recours aux connotations des signifiants, strictement sollicités pour leur valeur pathétique et non référentielle, montre bien que, faute de raisonnement construit, les mots servent d’épouvantails utiles à la diabolisation.
A ce titre, l’accusation envers Georges Bensoussan est symptomatique d’une stratégie argumentative globale qui permet de contourner la réalité. On trouve certaines caractéristiques du discours militant post-moderniste, en l’occurrence celui de l’islam, construit sur le paradigme victimaire. Dans le cas des attentats islamiques qui ensanglantent régulièrement la planète, l’argumentation est toujours la même :
- déni (il n’y a pas eu d’agression, l’islam n’est pas responsable)
- atténuation (c’est une minorité, ce n’est rien par rapport aux morts sur la route ; cela n’a pas de dimension politique ni religieuse, ce ne sont pas de vrais musulmans, etc. )
- excuse (ils ne savaient pas ce qu’ils faisaient ; ils ont été embrigadés ; ils y ont été poussé par l’abandon et la pauvreté)
- retournement (c’est la faute de la colonisation, de la situation politique)
- accusation (pointage de la victime : Israël, la France, l’Occident, les USA).
On retrouve dans le procès de Georges Bensoussan tous les éléments de cet arsenal argumentatif :
- déni (il n’y a pas d’antisémitisme musulman)
- atténuation (en tout cas pas plus que chez les autres, c’est très minoritaire, etc. )
- excuse (ils subissent la vexation du regard malveillant de la société)
- retournement (tout vient du ressentiment colonial, des accusations d’antisémitisme et du contexte social)
- accusation (c’est Georges Bensoussan attise les tensions et incite à la haine).
Cette stratégie est mise en œuvre par une tactique rhétorique fondée sur un arsenal grammatical (manipulation de l’actif / passif, de la causalité), lexical (vocabulaire victimaire) et stylistique (incantation hyperbolique, conglobation, pathos, etc.). Cette stratégie consiste à masquer la réalité et c’est la rhétorique qui permet cet évitement des faits et cette construction des positions manichéennes de victime / oppresseur.
Mauvaise foi, déni, obscurcissement de la réalité permettent ainsi à la fois de nier la réalité (il n’y pas d’antisémitisme musulman) et de l’expliquer (il vient d’Israël et de la stigmatisation sociale) pour faire du porteur du constat le fauteur de trouble. Dans cette argumentation fondée sur une « post-réalité », c’est-à-dire une manipulation de la réalité, on lit un militantisme idéologique et une position partisane qui ne s’intéressent qu’à mener une offensive juridique dont l’objectif est d’imposer une pensée et de mettre hors-la-loi ses adversaires. L’enjeu est bel et bien d’éliminer la possibilité même d’exprimer une position adverse. Cette démarche d’accusation ne consiste pas à défendre des idées par le débat mais à porter le débat dans le cadre de la justice.
Le jugement et l’apaisement
La relaxe a été prononcée à la suite d’un jugement développé sur plus de quatre pages qui analyse, de manière souvent fine, le débat radiophonique d’où les propos incriminés étaient tirés.
Le jugement considère avec justesse que l’accusation de racisme n’est pas constituée :
« l’expression critiquée n’est, à l’évidence, qu’une catachrèse, l’accusation biologique formulée par certaines parties civiles à l’encontre du prévenu en raison de la référence au lait maternel reposant sur une analyse par trop littérale »
On remarque néanmoins qu’il a fallu une exégèse stylistique des propos, ce qui confirme la fragilité du jugement, soumis à une appréciation pour ainsi dire poétique des formulations incriminées. La clairvoyance du jugement contraste avec la mauvaise foi de l’accusation, qui est le véritable enjeu de cette confrontation entre le droit et l’idéologie militante.
Par ailleurs, il est rappelé les éléments constitutifs du délit :
« une provocation, c’est-à-dire non pas forcément une exhortation, mais un acte positif d’incitation manifeste à la discrimination, à la haine ou à la violence, ce qui n’exige pas un appel explicite à la commission d’un fait précis, dès lors que, tant par son sens que par sa portée, le propos tend à susciter un sentiment d’hostilité ou de rejet à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personne déterminé à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion, étant précisé que pour caractériser ce délit, il n’est pas nécessaire que le message vise individuellement chaque personne composant le groupe considéré, l’infraction étant constituée dès lors que la teneur ou la portée du propos, en lien direct avec l’origine, l’ethnie la nation, la race ou la religion, rejaillit sur la totalité de la communauté ainsi définie, mais qu’en revanche, il n’y a pas de délit quand est seulement visée une catégorie de personnes qui se distingue du groupe par des comportements spécifiques, auxquels le groupe dans son ensemble n’est pas assimilé » (p. 7)
Indépendamment du cas d’espèce, on constate que les définitions juridiques des notions de « haine », « hostilité » et « rejet » ainsi que de « provocation » et « incitation », aussi techniques puissent-elles être, se heurtent à une appréciation subjective. L’idée que l’acte pour être caractérisé doive être « manifeste » suppose en effet l’établissement d’un jugement perceptif et d’une échelle d’évidentialité. On entre là dans le domaine de la subjectivité. De même, si la notion de « haine » (qui s’alourdit de son poids axiologique et de la condamnation morale qu’elle comporte) n’est pas problématique sur le plan sémantique, elle l’est sur le plan de sa réalité pragmatique : comment peut-on, pratiquement, déceler la haine ?
C’est une opposition entre le plan sémasiologique (le sens du signe) et onomasiologique (les manifestations du référent). En d’autres termes, on sait définir le mot « haine » ou le mot « manifeste », mais comment en repérer des occurrences dans le réel qui soient indiscutables et qui ne soient pas sujettes à une interprétation subjective ? Au reste, l’objet même du procès est précisément constitué par le fait que l’appréciation des propos diverge selon les parties. On pourra par exemple se demander en quoi l’expression d’une pensée est constitutive d’une incitation ou d’une provocation.
Le rapport entre axiologie négative des propos et ses effets est pareillement sujet à une appréciation difficilement objectivable. Comment constater l’existence effective du sentiment de haine ? Chez qui ? Comment la haine se manifeste-t-elle ? On remarque qu’on aborde un terrain philosophique et psychologique particulièrement glissant comme le montre la formulation du jugement qui parle d’« incitation à la haine ou à la violence » : la conjonction alternative exprimée par « ou » distingue justement deux ordres de phénomènes : la haine est une représentation psychologique, la violence un fait observable. On peut fort bien haïr sans agir — c’est du reste ce que font la plupart des humains…
Au-delà de la question de la liberté d’expression, c’est la question de la caractérisation et de l’appréciation juridiques qui est ici posée car cela touche à des faits sociaux, psychologiques et idéologiques dont les définitions et les manifestations ne sont pas stables. Toute négativité portant sur des groupes humains est-elle fondamentalement susceptible de porter atteinte à ce groupe ? L’expression de la détestation est-elle illégale ? C’est un pan de l’humain tout entier qui est susceptible de basculer dans le juridisme.
Les frontières sémantiques sont par ailleurs cruciales. Qu’est-ce qui distingue « l’expression » de « l’incitation » ? Qu’est-ce qui distingue un discours critique d’un discours de haine (i.e., qui « tend à susciter un sentiment d’hostilité ou de rejet ») ? On se trouve visiblement proche de ce que le linguiste Antoine Culioli appelle « la zone frontière » d’une notion plutôt que son centre définitoire. Le risque est celui d’une déformation où l’on considère un cas limite de la même manière qu’un cas tranché, ce qui aboutit à une torsion totale de la signification des notions : critiquer l’antisémitisme d’un groupe reviendrait alors à vouer ce groupe à la haine. Dénoncer la haine deviendrait un acte de haine… Cette circularité montre l’enfermement absurde dans lequel Georges Bensoussan s’est retrouvé enferré. Là encore, on ne peut apprécier la situation sans prendre en considération des données politiques objectives : ce sont les Juifs qui sont l’objet d’agressions et pas les présumés antisémites.
Il faut se méfier de la toute-puissance des catégorisations — politiques, morales, idéologiques, juridiques — dont la convergence peut être incontrôlable : l’accusation frénétique de racisme fait partie de ces procédés émanant d’une forme de militantisme. Le droit est perméable au discours idéologique, or la justice est aujourd’hui saisie en permanence pour juger de la conformité idéologique des propos. Il y a là un risque d’instrumentalisation de la loi qui peut conduire, par la subjectivité idéologique en jeu, à l’instauration d’un arbitraire, et assurément à une méfiance généralisée dont la pression fait office de censure.
On constate ainsi dans le jugement la présence d’une remarque qui montre l’importance de l’interprétation des propos :
« Ainsi, même si, dans un premier temps, l’expression « un autre peuple qui se constitue au sein de la nation française » peut être analysée comme relevant d’une démarche d’exclusion, cet « autre peuple » étant au surplus accusé de faire régresser la démocratie […] » (p. 10)
Sur le plan discursif, il est particulièrement étrange d’attribuer à celui qui décrit un séparatisme culturel la responsabilité de son existence. C’est seulement dans un deuxième temps que le jugement prend en compte le fait que Georges Bensoussan a « illustr[ant] sa réflexion […] il s’est appuyé sur trois éléments » et qu’il a pris
« soin de préciser que ses propos visent « les territoires aujourd’hui où la présence musulmane est forte et où il y a les salafistes » […] que ce faisant, il ne saurait lui être reproché de stigmatiser l’ensemble de la communauté musulmane, son constat, sa critique et ses inquiétudes portant uniquement sur une partie de cette communauté, salafistes ou personnes sous leur emprise. » (p. 10)
Le jugement a pris comme argument principal et récurrent, le fait que Georges Bensoussan ait distingué entre certains musulmans et d’autres. C’est principalement sur cette dimension qu’il se fonde pour la relaxe :
« il n’y a pas de délit quand est seulement visée une catégorie de personnes qui se distingue du groupe par des comportements spécifiques, auxquels le groupe dans son ensemble n’est pas assimilé » (p.7)
Cette stratégie argumentative pose un problème de fond qui concerne l’évacuation de la réalité. Et s’il s’était agi de l’ensemble du groupe ? De plus, la question du sous-groupe n’est posée par le jugement que pour défendre les propos de Georges Bensoussan concernant « un autre peuple qui se constitue au sein de la nation française » et pas pour la question de l’accusation d’antisémitisme. A ce titre, le jugement aborde deux assertions de Georges Bensoussan, l’une qui concerne l’antisémitisme musulman, l’autre qui concerne le sécessionnisme culturel islamique et plus particulièrement salafiste. Les deux assertions n’ont donc pas le même niveau de généralité : l’antisémitisme musulman est une donnée culturelle et historique internationale, tandis que le rapport à la République française est par définition plus circonstanciel et porte sur « les quartiers » et les développements politiques et sociaux récents.
En fait, le jugement répond essentiellement à la question de l’intégration nationale et fort peu à celle de l’antisémitisme. C’est du reste troublant puisque, car, au fond, sur le thème de l’antisémitisme, les propos de Smaïn Laacher, de Mohamed Sifaoui et de Georges Bensoussan posent bel et bien la question du rapport qu’entretient l’ensemble de la population musulmane avec l’antisémitisme. C’est aussi le constat de Daniel Sibony dans ses nombreux ouvrages : peut-on écarter dans la description culturelle de l’islam le fait que le Coran, texte sacré fondateur de l’islam, maudisse les Juifs ? Et que cette malédiction n’ait cessé dans l’histoire de prendre la forme de discriminations, d’agressions et de massacres ?
Le jugement retient également un autre argument considéré comme majeur : celui de la déploration :
« qu’enfin, et surtout, l’infraction de provocation à la haine, la violence ou la discrimination suppose, pour être constituée, un élément intentionnel ; qu’en l’espèce, la caractérisation d’un tel élément se heurte au fait que Georges Bensoussan, ainsi que le montre l’émission prise dans son ensemble, n’a eu de cesse de déplorer cette constitution de deux peuples séparés, de pointer la défaillance selon lui des « élites françaises et intellectuelles, médiatiques, politiques » et d’appeler non pas à une séparation de la fraction supposée avoir fait sécession, à son rejet, son bannissement ou son éradication, mais au contraire à sa réintégration dans la nation française » (p. 11).
Il est légitime que le jugement prenne en compte l’argumentation globale qui s’était déployée durant le débat radiophonique, mais comment la critique de Georges Bensoussan pourrait-elle être autre chose qu’une déploration ? C’est comme si le jugement même aboutissant à une relaxe évitait de statuer sur la réalité des propos de Georges Bensoussan. Le jugement repose sur la distinction entre le tout et la partie : comme Georges Bensoussan a été nuancé et qu’il n’a pas condamné l’ensemble des musulmans, il est relaxé… C’est un évitement de la question de la réalité : et si on pouvait prouver que « tous » les musulmans étaient concernés, alors quel serait le verdict ? De fait, on ne peut jamais prouver ni l’existence d’un « sentiment », ni un comportement, ni sa présence chez chaque individu appartenant à un groupe ! Ce qu’on exige est alors une fiction logico-juridique.
Généricité et pluriel : l’individu, le groupe et la catégorisation
La loi décrivant la provocation à la haine est formulée d’une manière très générale qui laisse une large part à l’appréciation. En particulier, le rapport entre l’individu, le groupe et l’appartenance sont des notions qui dépassent le cadre juridique et nécessitent d’être analysées sur le plan linguistique.
Le jugement précise qu’il y a délit d’incitation lorsque
« la teneur ou la portée du propos, en lien direct avec l’origine, l’ethnie la nation, la race ou la religion, rejaillit sur la totalité de la communauté ainsi définie, mais qu’en revanche, il n’y a pas de délit quand est seulement visée une catégorie de personnes qui se distingue du groupe par des comportements spécifiques , auxquels le groupe dans son ensemble n’est pas assimilé »
C’est le verbe « rejaillir » qui est le pivot de l’appréciation subjective : il peut aussi bien désigner des actes que des propos ou des sentiments dont la gravité est parfaitement floue. La formulation repose également sur la marque linguistique du pluriel et l’articulation d’un propos avec le groupe qu’il désigne.
Rappelons quelques principes linguistiques qui concernent le rapport entre le pluriel, le groupe et l’individu. Le simple fait d’employer un mot renvoie aux propriétés qui le caractérisent : dire « un stylo », c’est poser son appartenance à la catégorie « stylo », commune à d’autres exemplaires, indépendamment des particularités personnelles de chaque exemplaire (forme, marque, couleur, mode d’écriture, etc.). De la même manière, dire d’un individu qu’il est musulman (ou roux, grand, bourguignon, jeune, tennisman, etc.), c’est le faire entrer dans la catégorie « musulman », « roux », « bourguignon », etc. c’est-à-dire retenir la qualité particulière qui le relie à d’autres exemplaires du groupe. En d’autres termes, « Ce qui se pluralise, c’est ce qui se compare »,[11] et, partant, ce qui, potentiellement, se distingue car cela permet de « regrouper le différent sans l’unifier absolument ». Car l’opération de pluralisation regroupe en fonction d’un ensemble de caractéristiques qui s’appliquent de manière différente pour tous les membres d’une classe d’objet. Etablir les caractéristique d’une classe consiste à rapporter à la typicité, pas à l’intégralité des individus qui la compose — surtout pour une classe ouverte comme les groupes humains.
Il ne faut notamment pas prendre au pied de la lettre l’opération de pluralisation ou de renvoi à un groupe : la généricité linguistique ne se veut pas absolue. En d’autres termes, on peut trouver l’islam antisémite sans que tous les musulmans le soient. Au reste, dans l’argumentation sociale comme dans toute entreprise de connaissance, le principe aristotélicien « il n’y a de science que du général » s’applique sans que les groupes soient considérés comme des totalités organiques fermées ou homogènes. Dire « les bourgeois », « les ouvriers», « les enseignants », etc. désignent des regroupements qui n’essentialisent pas. Une catégorisation linguistique comporte un centre définitoire mais aussi une zone frontière, ce qui autorise la variation individuelle. En d’autres termes, la scalarité est toujours possible : le « plus ou moins » s’applique ainsi à toute notion et la généricité sociale s’accompagne implicitement de nuances comme « souvent », « plutôt », « ont tendance à » (l’identité musulmane peut ainsi s’échelonner : croyant, pratiquant, militant, intégriste, etc.).
La vraie question n’est donc pas celle de la généralité des propos mais le contenu du propos lui-même : dire « Les Juifs aiment l’argent », c’est attribuer une propriété négative, la cupidité, comme caractéristique définitoire. Il faut alors constater l’historicité de tels propos qui ont effectivement servi à la persécution des Juifs. Ce n’est pas le cas de l’accusation d’antisémitisme envers les musulmans qui n’ont jamais été persécutés pour cela.
Le jugement, tout en innocentant le prévenu grâce aux nuances qu’il a apportées, fait comme si un locuteur qui utilise le pluriel ne distinguait pas entre le tout et les parties. Le pluriel intègre la différence dans la mesure où il permet justement la singularisation. C’est ce qui autorise à distinguer un élément d’un ensemble, à distinguer « un musulman » et « les musulmans »… et de concevoir cette différence comme une construction dynamique (« un musulman pas comme les autres »). La connaissance repose sur la possibilité de faire des va et vient entre ce qui est spécifique et singulier et la classe dont il fait partie : singulier et pluriel sont solidaires. L’argumentation de Georges Bensoussan consiste justement à décrire des comportements et des sentiments dont l’existence chez certains musulmans se traduit par la violence, la sécession culturelle, etc. ce qui pose la question des fondements culturels permanents comme l’antisémitisme.
En ce sens, les propos de Georges Bensoussan ne concernent pas les musulmans « à raison de leur origine ou de leur appartenance » mais à raison de l’antisémitisme, de comportements anti-républicains ou criminels : par une logique discursive implicite, cela ne désigne que ceux parmi les musulmans qui sont concernés par ces qualifications. La question est bien d’expliquer le passage à l’acte de quelqu’un comme Mohamed Merah dont le frère expliquait lui-même « que sa mère lui disait enfant « nous les Arabes on est né pour détester les juifs » [sic, dans le jugement]. De toute évidence et sauf à nier toute validité aux principes de la méthode sociologique, historique et à la simple observation, l’atmosphère culturelle possède une incidence sur le comportement d’un groupe social. Toute la problématique des propos de Georges Bensoussan est justement que le « bain » culturel antisémite est propice à un passage à l’acte et que « une partie de la France » a pu approuver les attentats de janvier 2015 (Bataclan et Hyper Casher). Par une évidence discursive implicite, la question du comportement de l’individu au sein du groupe est précisément ce dont parle Georges Bensoussan : certains individus passent à l’acte, mais ce passage à l’acte se fonde sur des croyances, des habitudes, des comportements qui sont commun au groupe.
Une classe est constituée d’une hétérogénéité d’individus mais qui sont reliés par des caractéristiques communes : c’est justement cette articulation qu’il faut étudier. Faire comme si la généralisation était absolue, c’est méconnaitre un mécanisme discursif fondamental, à savoir qu’un énonciateur utilise la généricité dans le cadre d’une argumentation spécifique en utilisant des éléments préconstruits et souvent implicites. On parle toujours en fonction d’une thématique particulière. L’implicite argumentatif est qu’un propos porte toujours sur « la portion de la classe qui est concernée ». Quand on dit « j’aime le fromage », l’énonciateur valide un propos concernant la classe « fromage » indépendamment des fromages qu’il ne mange pas et qu’il n’aime pas. Un énoncé comme « J’aime les vins de Bordeaux » n’implique pas que l’énonciateur ait une expérience gustative effective des dizaines de milliers de vins constitutifs de la classe « vins de Bordeaux » et n’implique pas qu’il aime réellement l’intégralité des vins appartenant à cette classe, depuis le Bordeaux de table médiocre jusqu’au Château Cheval-Blanc. Dire « les vins de Bordeaux », c’est faire référence à un type : la classe est envisagée en compréhension et non en extension.
Parler d’« antisémitisme musulman » ne signifie pas forcément que tous les musulmans soient antisémites — et des énoncés comme « les musulmans sont antisémites » ne renverraient pas non plus à une qualité en extension. De plus, les implicites discursifs sont nombreux et il serait étrange d’en énoncer toutes les propriétés et toutes les nuances et les manifestations à chaque mention (caractéristiques historiques, théologiques, géographiques, culturelles, etc.) ainsi que l’argumente le jugement qui se fonde sur les nuances apportées dans l’émission par Georges Bensoussan. Il en va ainsi de la mention des familles arabes, généralisation qui se justifie par le fait que l’antisémitisme islamique en question est celui qui se manifeste au sein d’une population majoritairement arabe et que l’islam se fonde sur un texte écrit en arabe. Il s’agit manifestement d’une métonymie, assez courante du reste. Fatalement, surtout à l’oral, on trouvera le raccourci « arabe » pour « arabo-musulman » sans qu’il faille le prendre au sens littéral (c’est là aussi de cette manière que Smaïn Laacher avait utilisé ces termes).
Ce n’est donc pas la question de la généralité et du renvoi au groupe qui pose problème mais la question de la réalité de l’imputation. A ce titre, le jugement semble avoir utilisé la problématique de la généricité comme une échappatoire, permettant l’évitement du constat socio-politique lui-même.
L’idéologie et les mots
Cette question de la métonymie, du tout et de la partie, n’est pas ici articulée à sa problématique sociologique (l’individu, le groupe, la société) mais à sa manifestation dans le langage ordinaire et son potentiel délictueux dans le cadre de formulations juridiques. De gregibus nihil nisi bonum ? Faut-il ne parler qu’en bien des groupes ? Si l’expression de la désapprobation envers un groupe est considérée comme lui portant atteinte, les frontières de la critique légitime deviennent floues, ce qui, de facto, constitue une limite à la liberté d’expression. De plus, la réalité effective décrite par les propos est évacuée de la description légale, car la considération prise en compte est que cela « rejaillit sur la totalité de la communauté ». Si l’on suit cette logique, il n’est pas besoin que la réalité confirme les déclarations pour que ces déclarations, si elles sont négatives, soient de toute manière de nature à provoquer la haine — y compris s’il s’agit, comme c’est le cas en l’espèce, de dénoncer la haine…
Il y a donc là un ensemble de prescriptions linguistiques qui s’inscrivent dans la protection de l’appartenance identitaire. Mais cela n’est pas indépendant d’une ambiance idéologique particulière. Le contraste est saisissant entre la défense militante de l’islam dans les cours de justice et l’omniprésence des discours de haine envers les Juifs, les Français, les Blancs, les Catholiques, les policiers, cibles d’appels aux meurtres explicites, qu’une simple bande-son permet de classer dans le registre de l’expression artistique. Les discours et pratiques misogynes et homophobes provenant du monde musulman sont rarement poursuivis alors que leur réalité est quotidienne.
L’enjeu du procès de Georges Bensoussan est qu’il met à mal la polarisation manichéenne du dispositif idéologico-politique dominant en France. L’orthodoxie idéologique française repose sur un versant positif (exaltation de la République, de la diversité…) et sur un versant négatif (condamnation du racisme, de l’antisémitisme, du fascisme, du nazisme). Dans ce narratif identitaire, qui a lui seul possède des responsabilités dans le délitement français, les musulmans sont censés être des victimes, pas des oppresseurs.
Ce cadre métonymique est le lieu d’un jeu permanent où l’identité musulmane se voit protégée et assignée un rôle angélique destiné, fatalement, à se fracasser contre le réel. C’est ainsi que l’on tente en permanence de dissocier l’islamisme de l’islam, le terrorisme islamique de la population musulmane qui pourtant ne le condamne pas toujours. On assiste ainsi à la répétition permanente d’un mantra argumentatif en forme de déni paradoxal : les terroristes musulmans ne sont pas des vrais musulmans. C’est ce dispositif hypocrite qui opposant le tout à la partie et l’islam aux musulmans, permet d’exalter l’islam comme religion de paix et d’amour tout en l’exonérant de tout crime commis par des musulmans revendiqués au nom de leur religion (et de faire semblant de ne pas savoir que l’histoire de l’islam est faite de colonialisme, de conquêtes, de massacres, d’esclavage). Cela explique la façon dont les terroristes sont systématiquement exclus par le discours politique et médiatique de la religion dont ils se revendiquent : « loup solitaire », « antécédents psychiatriques » et « vulgaire délinquant » sont les formules qui servent à exfiltrer de l’islam des individus qui pourtant ne sont pas issus du bouddhisme… La dynamique dialectique de la métonymie s’appuie sur le fait de singulariser l’auteur d’un crime pour innocenter le bain culturel dont il est le produit. Cette aberration sociologique d’un raisonnement où la causalité culturelle ne jouerait aucun rôle est en fait le produit d’un déplacement permanent : l’islam n’est jamais coupable de ce qu’il engendre, ce sont toujours l’Occident, les circonstances, Israël, etc. qui constitueraient les véritables acteurs des exactions islamiques.[12]
Seulement cette idéologie où l’islam occupe une place protégée se paye de mots. En célébrant des formules creuses (« vivre-ensemble », « tolérance », « République », « faire front contre le fascisme »), l’adoration fétichiste des signifiants constitue une véritable idolâtrie idéologique dont le discours représente une forme de croyance laïque. Comme cet agencement argumentatif est branlant, chaque irruption de la réalité menace sa solidité : attentats, meurtres, agressions, « dérapages » verbaux, etc. sont donc systématiquement l’objet d’explications de texte atténuatrices.
La célébration rhétorique des signifiants qui remplacent la réalité repose sur un dispositif axiologique clair : il y a le bon et le mauvais. L’horreur absolue, c’est le racisme, la discrimination, l’antisémitisme. Alors, si les supposées victimes du racisme se révèlent antisémites, la simplicité manichéenne de l’idéologie se fracasse et c’est toute cette organisation polarisée selon des critères moraux simplistes qui s’effondre. Le cadre idéologique qu’il faut sauvegarder malgré son incohérence nécessite donc de nier la virulence et l’abondance des discours musulmans antisémites, misogynes, homophobes, antirépublicains.
Quand l’idéologie vacille face à la réalité, il ne reste rien qu’une incantation vide et froide, désespérée, une frénésie de verbiage illogique s’agrippant aux derniers effilochements d’un dispositif mental mensonger. Un tel procès montre ce point de basculement : la minorité idéologiquement protégée (les musulmans) se voyant décrite comme coupable de haine envers une minorité idéologiquement protégée mais politiquement et socialement sacrifiée (les Juifs), les gardiens de l’orthodoxie idéologique et identitaire se servent alors de l’accusation morale pour la retourner et en faire une accusation juridique.
L’arsenal rhétorique permettant le déni tente de s’imposer dans les prétoires. Les associations militantes, souvent subventionnées par l’Etat, s’y installent régulièrement pour affûter son efficience juridique et intimider les contrevenants. La justice, déchirée entre son pouvoir autonome, ses liens avec les pouvoirs en place et la pression politique générale, est soumise à des manipulations. Il n’est pas interdit de penser qu’il existe désormais le risque qu’au sein de la justice, les préférences idéologiques prennent le pas sur l’objectivité. Il devient ainsi très aléatoire, en une période de judiciarisation des propos antidoxiques, de passer devant un juge pour tester sa résistance à ce que Jean-Pierre Faye aurait décrit comme « le langage totalitaire ».
Conclusion
Certaines figures des banlieues deviennent les chouchous des médias et des maisons d’édition malgré des discours homophobes et antisémites. Inversement, tout contrevenant à l’idéologie en vigueur peut être traduit en justice pour une formulation, une hyperbole, une approximation de chiffre, une métaphore.
On mesure à quoi tiennent les décisions de justice : « déploration » et non « exhortation », « catachrèse » et non « métaphore », « une partie » et non « l’ensemble du groupe »… La subtilité de l’exégèse juridique s’est fondée sur la continuité de l’émission où figuraient les propos incriminés. En d’autres termes, ce sont les nuances (« une partie de ») figurant ailleurs qui ont en quelque sorte sauvé la mise de Georges Bensoussan. L’accusation s’est réduite à l’utilisation incantatoire des signifiants, typique de l’absence de raisonnement et de la mauvaise foi d’un faux débat. La réprobation morale et la diabolisation à l’aide du mot « racisme » est une arme rhétorique qui fait partie de l’arsenal idéologique plus large construit sur une opposition manichéenne radicale.
Il faut donc pour comprendre que puisse se tenir de tels procès tout le contexte politique et idéologique. Les raisonnements aberrants qui ont désormais cours dans les médias français (le voile est une liberté ; la shariah n’est pas incompatible avec la laïcité, etc.) s’ajoutent à nombre de paradoxes irrésolus : « Il n’y a pas d’islamisation de la société française » fait partie du même arsenal argumentatif que « L’islam fait partie intégrante de la société française ». Cela montre à quel point tout notre rapport au langage se trouve affaibli et émietté, comme si le choix des mots suffisait à créer une réalité alternative qui ait force de loi.
Ainsi, la convergence de multiples événements médiatiques fait discours. Le documentaire intitulé Un peuple élu et mis à part, l’antisémitisme en Europe, réalisé par les cinéastes Joachim Schröder et Sophia Hafner, a d’abord été censuré par la chaîne Arte parce que sa démonstration n’entrait pas dans le cadre idéologique attendu selon lequel l’antisémitisme ne saurait qu’être le produit de l’extrême-droite et soulignait le rôle de l’antisémitisme musulman. La sous-médiatisation du meurtre de Sarah Halimi s’est accompagnée du déni de l’antisémitisme islamique qui l’a causé. Quand on constate par ailleurs l’exploitation de la Shoah dans l’entre-deux tours de l’élection présidentielle, on constate à quel point le signe juif s’articule dans la société française selon un montage spécifique. Le Juif-victime-d’antisémitisme est le repoussoir de l’extrême-droite et l’on refuse catégoriquement que cet antisémitisme puisse être causé par un acteur différent. C’est alors le signe musulman qui est nié et dont on refuse de reconnaître le lien avec un antisémitisme ancré dans sa culture comme dans ses textes.
C’est finalement toujours le même montage qui a lieu : d’un côté une exagération des turpitudes de l’adversaire idéologique ramené à la valeur transcendante qu’est le racisme (Israël est raciste, Georges Bensoussan est raciste, etc.) ; et de l’autre côté, une atténuation de la violence islamique à laquelle on trouve des prétextes qui servent de diversions (cas psychiatrique isolé ; ressentiment colonial ; frustration sociale ; oppression sioniste). C’est ainsi que les jeux de langage qui permettent de contourner la factualité sociale, politique et culturelle, permettent également de retourner les rapports éthiques et juridiques et de transformer la vict
[1] Outre l’assassinat de Sarah Halimi, rappelons quelques incidents récents : l’opposition de Nassim Lachelache, élu de Fontenay-sous-Bois, face à la venue du chanteur israélien Amir Haddad, la comparution des membres de la filière de Cannes-Torcy qui avait fomenté en 2015 un attentat anti-juif avorté à Sarcelles, l’affaire Medhi Meklat dont les tweets antisémites ont été mis sur le compte d’une forme de « poésie pure », le procès contre Eric Zemmour pour avoir déclaré concernant les musulmans qu’il fallait « leur donner le choix entre l’islam et la France » (poursuivi sur citation directe de l’association CAPJPO-EuroPalestine), le racisme discriminatoire évident de « Nyansapofest, premier festival afro-féministe européen » qui prétendait interdire certains espaces aux blancs, etc. Telle est l’ambiance agressivement identitaire qui caractérise désormais la France…
Jean Szlamowicz
Professeur de linguistique à l’Université de Bourgogne
[2] Parmi les plus récents, outre les ouvrages de Georges Bensoussan lui-même, signalons Un certain vivre-ensemble. Musulmans et juifs dans le monde arabe, de Daniel Sibony (2016, Odile Jacob) ou l’étude de Mehdi Ghouirgate, Iannis Roder et Dominique Schnapper, France : Les Juifs vus par les musulmans. Entre stéréotypes et méconnaissances (2017, Fondapol/ AJC).
[3] Les citations proviennent de la copie de travail du jugement du 07/03/17 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris (17e chambre correctionnelle).
[4] Je l’ai décrit dans Détrompez-vous ! Les étranges indignations de Séphane Hessel décryptées, Intervalles, 2011.
[5] C’est le cas pour Israël dont le nom ne survient dans les esprits qu’associé à « racisme », « occupation », « apartheid », etc. C’est le fruit d’un militantisme lexical incessant. Il est intéressant que ceux qui représentent les valeurs occidentales comme l’antiracisme, soient les premiers à en être accusés. Les Juifs sont évidemment en première ligne mais c’est toute une stratégie de retournement des droits de l’homme qui pèse aujourd’hui contre l’Occident.
[6] Lire The Legacy of Islamic Antisemitism: From Sacred Texts to Solemn History, Andrew G. Bostom (2008, Prometheus Books) et Szlamowicz Jean, « Historiens, journalistes, pédagogues face à l’islam : Discours de l’occultation, de l’euphémisation et du révisionnisme » (Controverses, n° 18, Déc. 2011, pp. 143-162)
[7] “Les Arabes ne visitent pas Auschwitz”, Huffingtonpost, 23 avril 2015.
[8] http://obs.monde.juif.free.fr/ et http://www.sosantisemitisme.org/
[9] In Vacarme, n° 71, Paris, printemps 2015. Elle a par ailleurs écrit un ouvrage intitulé Les Blancs, les Juifs et Nous…
[10] Le 1er avril 2017 par exemple où la préfecture a autorisé une manifestation « pour la séparation du CRIF et de l’Etat » ou encore le 15 Juillet 2016, http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1223934-affrontements-devant-une-synagogue-a-paris-mort-aux-juifs-ne-fait-plus-reagir-personne.html; ou encore celles du 13 juillet 2014 où furent attaquées les synagogues de la rue de la Roquette, de la rue des Tournelles et des commerces à Sarcelles (http://www.liberation.fr/debats/2017/04/21/reponse-a-gerard-miller_1564342): on proféra des appels au jihad, on agita les drapeaux du Hamas, du Hezbollah et de l’Etat Islamique : on cria bien sûr «mort à Israël» et «mort aux Juifs» — mais il s’agissait sans doute de « légitimes critiques de l’état d’Israël ». Rappelons aussi les agressions physiques récurrentes, comme récemment les deux Juifs de Bondy agressés à la scie (http://www.lemondejuif.info/2017/02/haine-du-juif-en-france-deux-juifs-agresses-a-bondy-les-agresseurs-ont-coupe-le-doigt-dune-des-victimes/).
[11] Laurent Danon-Boileau, « Dénombrement, pluriel, singulier », in Faits de langues, n°2, Septembre 1993. « Le nombre ». Référence valable pour les citations suivantes.
[12] Certains spécialistes de l’islam considèrent ainsi que l’islamisme ne serait qu’une forme de radicalisation offerte à la jeunesse indépendante de l’islam « réel » (ces discours se servent notamment des terroristes convertis pour innocenter la culture musulmane) et qu’il faudrait attribuer aux fonctionnements de nos sociétés et notamment aux discours d’exclusion dont seraient victimes les musulmans. C’est le retournement que j’ai déjà évoqué : l’islam n’est pas responsable de l’islamisme, l’Occident est responsable de la radicalisation. Comme si la « radicalisation » n’était pas, de fait, la norme culturelle des pays musulmans dénués de liberté religieuse, d’égalité des sexes, de représentation démocratique, etc. Comme si la sharia était une invention occidentale contemporaine.